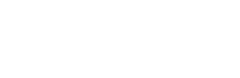Plus de 6 millions de décès dus à la Covid-19 dans le monde dont plus de 2 millions en Europe. Un bilan qui s’est accompagné depuis le début de l’épidémie par de l’incompréhension et des critiques à l’égard de la communauté scientifique. À cela s’est greffée une critique très vive de la part de la société civile à l’égard du manque de préparation face à une telle crise, et des négligences quant aux efforts scientifiques qui auraient permis de mieux anticiper la pandémie. La critique a aussi porté sur l’incapacité des pouvoirs publics à proposer des moyens d’y remédier.
Pourtant, dès les débuts de la crise, de nombreuses recherches de vaccins ont eu lieu, avec plus de 50 pays candidats au niveau mondial. Des séries de tests ont permis de valider plusieurs d’entre eux. L’ambition était de prévenir le risque de contamination et d’expansion du virus. Cependant, malgré les résultats publiés, le virus se répandait comme une trainée de poudre en attendant la mise sur le marché des premiers vaccins. Les mesures barrières envisagées et préconisées ont, certes, favorisé un ralentissement de sa propagation, mais n’ont pas épargné les scientifiques de critiques parfois virulentes relatives à leur manque de performance. Cela en dépit des multiples mobilisations de la communauté académique. La science aurait-elle pu faire mieux ? Aurait-elle pu mieux anticiper le risque ?
L’impossibilité d’anticiper sans prendre en compte les aléas
Pierre-Antoine Chardel, philosophe et sociologue à l’Institut Mines-Télécom Business School, est intervenu en mai 2022 sur le thème des paradoxes de l’anticipation, dans le cadre du séminaire Éthique de la recherche, intégrité et responsabilités scientifiques en situation de crise sanitaire intitulé “De quelle science avons-nous besoin ?”. Il y rappelait que « l’un des paradoxes de l’anticipation est qu’elle nous impose, dans son ambition même, de faire intervenir son impossibilité ». Or tout un imaginaire nous a familiarisé avec un fantasme d’une maîtrise totale du risque en général. Au moment le plus haut de la crise, un manque de préparation s’est fait ressentir : « Le choc fut d’autant plus important qu’il existe un imaginaire assez puissant de la maîtrise des risques dans nos sociétés technologiques. Nos modes de vie hypermodernes n’étant pas étrangers à ce fantasme de pouvoir tout contrôler », précise Pierre-Antoine.
Un idéalisme de l’anticipation qui prend en outre de la place dans les imaginaires sociaux. Nous pourrions dans un tel contexte tout prévoir, tout anticiper. Aujourd’hui, avec le développement des algorithmes par exemple, l’information nous est amenée avec des logiques de recommandation. Cela peut entraîner les individus à s’enfermer davantage dans des bulles informationnelles, créant ainsi de redoutables « zones de confort », en les familiarisant avec l’idée que tout est susceptible d’être anticipé.
L’ambition d’anticipation est ancrée dans le projet même de la modernité. À la suite du tremblement de terre de Lisbonne de 1755 (qui fit près de 60 000 victimes), les savants de l’époque marquèrent leur volonté de prévoir – et ainsi d’éviter – à l’avenir ce type de catastrophe naturelle. La science et la technique furent alors imaginées comme l’affirmation d’un pouvoir souverain sur la nature. Or près de trois siècles plus tard, les séismes constituent toujours des catastrophes naturelles difficilement prévisibles.
Un tel idéal de la prévision se retrouve avec le positivisme qui consiste à envisager les faits sociaux comme des choses, et l’ambition de soumettre le monde social à des statistiques, à des chiffres. Pierre-Antoine Chardel précise néanmoins ici que « c’est plus le scientisme que la science elle-même qui laisse penser que nous pourrions tendre vers davantage de faculté d’anticiper… Car la science intègre l’aléa dans ses modes de raisonnement ». Néanmoins, certaines prévisions, comme celles de la crise sanitaire, peuvent être considérées comme de pures spéculations tant que le pire n’est pas devant nous. « De fait, s’il y a ne serait-ce qu’un an nous avions prédit que l’on pourrait confiner toute la population française durant 55 jours, puis imposer le couvre-feu à deux tiers d’entre elle, l’obliger à porter le masque, interdire les rassemblements de plus de six personnes, pour enfin reconfiner l’ensemble du territoire durant de longues semaines, on nous aurait rétorqué que cela ne pouvait être que pure fiction : aurions-nous trop lu de romans d’anticipation ? » s’interrogent Valérie Charolles et Laurent Quintreau dans « Les risques d’un biopouvoir disciplinaire ».
La nécessité d’intégrer l’imprévisible pour mieux prédire
D’un autre côté, les développements de la big data renforcent un imaginaire de la prédiction, ce qui correspond, au fond, à un idéal positiviste. « Il est vrai que l’anticipation est aussi corrélée à la puissance de calcul. Un enjeu est donc aujourd’hui de réintégrer l’imprévisibilité dans les modes de raisonnement, en particulier dans le contexte de nos sociétés hypermodernes », rappelle Pierre-Antoine Chardel. Il précise à cet égard les apports du philosophe allemand Hans Jonas dans Principe Responsabilité. Ses réflexions nous conduisent à intérioriser l’idée que plus notre puissance technologique est grande et plus nous devons admettre notre impuissance à tout prévoir, et surtout à tout contrôler. Les effets de nos actions, en raison de la puissance acquise par les technologies, se situent au-delà de notre capacité de prédiction. Et ce fait dépasse le point de vue tacite de toute éthique antérieure consistant, compte tenu de l’impossibilité d’un calcul prévisionnel à long terme, à ne prendre en considération à chaque fois que le plus proche.
Il faut ajouter à cela un effet de déni qui intervient parce que notre société a été accoutumée à un monde sans heurts, sans aléas et avec des risques continuellement minimisés. Par conséquent, nous avons plus de mal à envisager les risques globaux qui peuvent porter atteinte à notre équilibre de vie sur le plan sociétal. Typiquement, au moment de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986, une sorte de déni collectif s’est organisé, comme le montrent les travaux du sociologue allemand Ulrich Beck dans La société du risque. Il mentionne une évolution de la société de modernité qui passe d’une logique de répartition des richesses à celle d’une répartition du risque. Ce concept est dès lors mis en avant comme critère fondamental de l’évolution de la société moderne.
La gestion collective du déni est révélatrice de la manière dont certains récits politiques entretiennent l’illusion de la maîtrise et du contrôle. Or il semble essentiel d’un point de vue éthique de reconnaître que si nous sommes désormais confrontés à certaines problématiques qui sont directement liées à nos modes d’existence hypermodernes, il est désormais temps d’admettre que « nous avons développé une manière contre-productive de les traiter, en provoquant le plus souvent un divorce entre le monde des experts et celui de la société civile, et plus largement une séparation entre la production scientifique et d’autres systèmes de connaissance des écosystèmes naturels, tels que certaines communautés à travers le monde ont développé par leurs modes de vie » pointe Pierre-Antoine. Toutefois, remédier à de telles insuffisances nous conduit à changer de cadre d’analyse pour penser notre modernité – ou notre hypermodernité – « de manière la plus réflexive que possible », renchérit-il. Une telle réappropriation est non seulement possible, mais nécessaire dans la mesure où certains grands défis (sur le plan environnemental notamment) ne peuvent passer outre les dimensions sensibles de notre « être au monde ». C’est notamment ce que développe Pierre-Antoine Chardel dans son ouvrage Socio-philosophie des technologies numériques. Ethique, Société, Organisations.