Dans les métiers du numérique, la mixité est une affaire d’inclusion, pas d’exclusion
Les réflexions sur la mixité sont souvent fallacieuses. La sociologie le montre : la responsabilité est attribuée aux femmes, à qui il incomberait de faire l’effort de s’inclure dans les espaces où elles sont minoritaires. Chantal Morley mène des études sur ce sujet à Institut Mines-Télécom Business School. Elle s’intéresse en particulier à la mixité dans les milieux technologiques, qu’il s’agisse des entreprises, des universités, des écoles d’ingénieur… Dans cette interview, elle revient pour I’MTech sur les bonnes approches de promotion de la mixité, mais aussi sur les mauvaises.
Vous proposez de ne plus réfléchir à la question de la mixité par le prisme de l’exclusion, mais plutôt par celui de l’inclusion. Quelle est la différence ?
Chantal Morley : Cette réflexion vient de l’observation du faible effet des mesures prises depuis 20 ans. Elles s’adressent exclusivement aux femmes sous la forme : « il faut que vous vous informiez, que vous fassiez l’effort de vous inclure ». Mais les hommes n’ont pas besoin de faire ces efforts-là, et l’histoire montre qu’à une époque les femmes n’avaient pas besoin de les faire non plus. Ces appels et injonctions ciblent les femmes à l’extérieur des espaces professionnels ou des territoires : c’est le prisme de l’exclusion. Les femmes seraient exclues et devraient résoudre cela par elles-mêmes. Penser en termes d’inclusion, c’est plutôt s’intéresser aux pratiques à l’intérieur des entreprises, des espaces de discussion, des formations. Il s’agit de questionner les mécanismes d’égalité, les attitudes, les représentations.
À lire sur I’MTech : Pourquoi les femmes sont devenues invisibles dans les métiers du numérique ?
Concrètement, quelle différence cela apporte-t-il ?
CM : Si les femmes ne vont pas dans les métiers du numérique, ce n’est pas parce qu’elles ne s’y intéressent pas ou qu’elles ne font pas l’effort d’y aller, mais parce que le domaine est marqué au masculin. Réfléchir sur ce qui se passe à l’intérieur de la frontière d’une organisation, c’est comprendre que la technique, dont les femmes ont longtemps été exclues, est un lieu d’affirmation de la masculinité. Aujourd’hui encore, une norme latente, souvent inconsciemment mobilisée, nous dit qu’un homme sera plus à l’aise dans les questions techniques. Signifier aux femmes qu’elles y sont étrangères, par de nombreux petits signes, contribue à la pérennité de cette norme. Il s’est ainsi développé une culture technique masculine que l’on retrouve dans les entreprises, les écoles, les universités. Cette culture est continuellement alimentée par certaines interactions au quotidien — entre élèves, avec les professeurs, entre professeurs, dans la communication institutionnelle — dont l’effet est d’autant plus fort que leur caractère socio-sexué n’est pas questionné. C’est pourquoi les pratiques doivent être questionnées, ce qui suppose que l’on s’attaque au problème en s’intéressant à ce qui se passe à l’intérieur des organisations.
Quels sont les obstacles à la mixité dans les milieux technologiques ?
CM : Les organisations renvoient des signes sur le marquage de leur territoire. Sur les sites web des entreprises, ce sont souvent des hommes qui sont représentés dans des métiers à responsabilité. Dans les écoles d’ingénieurs, les représentations sont également très masculines, des brochures d’écoles aux affiches de gala faites par les associations étudiantes. L’image du masculin est dominante. Et puis il y a une deuxième dimension, celle de la reconnaissance. Dans les métiers technologiques, les femmes sont souvent soupçonnées d’illégitimité, il est fréquent qu’on leur demande de refaire leurs preuves. Les femmes qui arrivent très haut dans la hiérarchie d’une entreprise, ou qui excellent dans les formations d’élite, ressentent ce soupçon discret qui peut les conduire à se remettre en question.
Comment bien réussir une politique d’inclusion ?
CM : Nous avons mené une étude sociologique sur plusieurs dispositifs d’inclusion mis en place dans des organisations. Un bel exemple de succès est celui de l’université Carnegie-Mellon, aux États-Unis. Dans un premier temps ils ont mené une analyse réflexive de leurs pratiques. Ils se sont rendu compte qu’ils mettaient eux-mêmes des barrières à l’entrée des filières technologiques pour les femmes. Par exemple, pour sélectionner des étudiants, ils les jugeaient sur une expérience en informatique antérieure à leur admission, mais non enseignées dans les cursus scolaires. Ils attendaient ainsi des étudiants qu’ils aient des compétences héritées d’une culture hacker ou d’un cadre social propice au développement de ces connaissances. Or, l’université s’est rendu compte que non seulement ces connaissances étaient préférentiellement partagées dans des milieux masculins, mais surtout qu’elles n’étaient pas déterminantes pour réussir les études. Les critères d’admission ont donc été revus. C’est un bel exemple d’analyse de l’espace de l’organisation en termes d’inclusion. En un an, la part des étudiantes en informatique est passée de 7 % à 16 %, et ce pourcentage a atteint de façon durable près de 40% au bout de quatre ans. Et le pourcentage de candidates admises qui faisaient le choix de s’inscrire a plus que doublé en quelques années.
À lire sur I’MTech : La mixité dans les TIC comme objet de recherche
Une fois les femmes entrées dans ces espaces, le problème est-il réglé ?
CM : Pas du tout. Là encore, l’exemple de l’université Carnegie-Mellon est bon. Les étudiantes abandonnaient en moyenne deux fois plus souvent leurs études en informatique que les hommes. C’est là qu’interviennent les notions de culture et de relations. Les nouvelles étudiantes étaient l’objet de rumeurs de quotas. Les hommes pensaient qu’elles n’étaient là que pour satisfaire des statistiques, parce qu’ils étaient eux-mêmes conditionnés par des clichés sur les compétences respectives des hommes et des femmes en informatique. La réponse de l’université a été de rendre obligatoire un cours de première année sur le genre et technologies pour démonter les idées reçues.
À quel point est-il nécessaire de passer par des dispositifs obligatoires ?
CM : Il y a deux raisons majeures. D’une part, les stéréotypes ont une action d’autant plus forte qu’ils sont activés de façon inconsciente : il faut donc créer des conditions permettant de changer le regard entre les personnes au sein d’un groupe. En l’occurrence, le cours obligatoire sur le genre ou les cours d’informatique différenciés en 1re année qui permettent à toutes et tous de suivre les mêmes cours en 2e année, augmentent la confiance en soi et créent un socle de connaissances communes. L’ensemble développe la motivation et l’envie d’aller de l’avant dans le groupe. D’autre part, les évolutions de culture sont généralement lentes, d’autant plus quand la population peu incluse est en très forte minorité. C’est pourquoi il faut poser la question des quotas. Tout le monde est très mal à l’aise avec cette idée, mais c’est une disposition transitoire qui permet une évolution rapide de la situation. Par exemple, la plus grande université des sciences et technologies de Norvège (NTNU), qui est aussi un cas de succès d’inclusion, a décidé d’ouvrir des places supplémentaires uniquement pour les femmes. Accompagnée d’une communication très lisible, cette disposition a permis de passer en un an de 6% à 38% d’étudiantes, et de créer rapidement une « communauté » d’informaticiennes. Le pourcentage d’admises s’étant stabilisé, les quotas ont été abandonnés au bout de trois ans. Et il faut aussi poser la question des espaces séparés. Carnegie-Mellon a, par exemple, poussé une association d’étudiantes en informatique, et lui apporte toujours un soutien. Cette association organise en particulier, avec l’aide de la direction de l’école, des rencontres avec des professionnelles, parce que les femmes se sentaient exclues des réseaux classiques des alumni. Elle est devenue l’association étudiante la plus importante du campus, et à présent que la période transitoire est passée, elle s’ouvre progressivement à d’autres formes de diversité, notamment ethnique.
Y a-t-il des mauvais dispositifs d’inclusion ?
CM : D’une manière générale, toutes les mesures visant à mettre en avant les femmes en tant que femmes sont problématiques. L’université des sciences et technologies de Norvège est à ce titre un bon cas d’étude. En 1995, elle avait lancé un programme d’inclusion en attirant les femmes sous l’angle de la différence, de la complémentarité par rapport aux hommes. Ce programme a eu un succès sur le plan statistique : il y a bien eu plus de femmes dans les filières technologiques. Et les enquêtes sociologiques ont montré que les femmes se sentaient voulues dans ces espaces de formation. Mais ces études ont aussi montré que les jeunes femmes étaient embarrassées, car parler de complémentarité impliquait que l’université considérait les points forts des femmes comme différents de ceux des hommes. Or ce n’est pas vrai, et on voit ici la différence fondamentale avec Carnegie-Mellon qui attirait les femmes justement en détruisant ce genre de clichés.
Depuis 1995, cette posture sur la complémentarité a-t-elle changé ?
CM : À l’université de Norvège, oui. Suite aux témoignages des étudiantes, le dispositif a été largement modifié. Malheureusement, le discours de la complémentarité est encore trop présent, en particulier au sein de l’entreprise. Trop souvent nous entendons des phrases telles que « une femme dans l’équipe améliore la communication », ou « une présence féminine permet d’adoucir l’ambiance ». Non seulement il n’y a aucune réalité sociologique derrière, mais surtout cela impose une qualité aux femmes qui sera attendue d’elles. C’est l’aspect performatif du genre : on se conforme à ce qui est considéré comme convenable et attendu de nous. Une femme très talentueuse dans une fonction qui ne demande pas de compétences de communication particulières se verra jugée préférentiellement sur ce critère plutôt que sur ses tâches. Il faut donc impérativement déconstruire cette représentation. Inclure les femmes n’est pas important pour améliorer l’ambiance dans une équipe. C’est important car elles représentent un vivier de talents tout aussi important que les hommes.
[divider style= »normal » top= »20″ bottom= »20″]
 Un MOOC pour combattre les stéréotypes sexistes
Un MOOC pour combattre les stéréotypes sexistes
Comment se construisent et s’entretiennent les stéréotypes ? Comment les caractériser et les déconstruire ? Comment favoriser l’insertion des femmes dans les métiers du numérique ? Chantal Morley est à l’initiative du MOOC Mixité dans les métiers du numérique pour répondre à ces questions. Chaque année, une nouvelle session de ce cours en ligne permet de découvrir la contribution méconnue des femmes au développement de l’industrie du logiciel, et par quels mécanismes elles sont aujourd’hui invisibilisées et découragées de s’investir dans le secteur. Le MOOC a pour objectif de sensibiliser les entreprises, les écoles et les organismes de recherche à ces problématiques, afin qu’ils aient les clés pour développer une culture plus inclusive à l’égard des femmes. L’accès au MOOC est libre et gratuit sur la plateforme FUN.
[divider style= »normal » top= »20″ bottom= »20″]



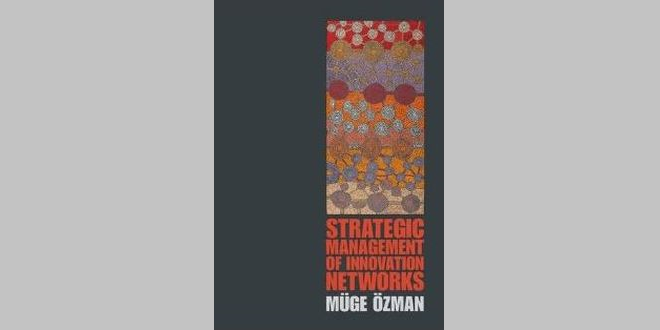

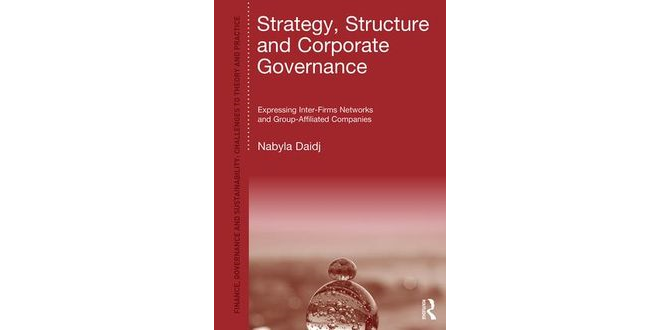




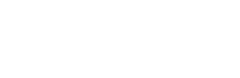


Trackbacks (rétroliens) & Pingbacks
[…] Dans les métiers du numérique, la mixité est une affaire d’inclusion, pas d’exclusion […]
[…] Dans les métiers du numérique, la mixité est une affaire d’inclusion, pas d’exclusion […]
[…] Dans les métiers du numérique, la mixité est une affaire d’inclusion, pas d’exclusion […]
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !