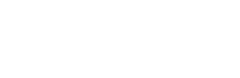Lors d’un festival bondé ou d’une rencontre sportive très attendue, vos vidéos ne s’envoient pas malgré vos nombreuses tentatives désespérées ? Sur un train à grande vitesse, votre visioconférence qui semblait stable il y a quelques kilomètres se fige soudainement ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas seuls. Ces scénarios, nous les expérimentons tous et toutes à l’ère de la 5G, qui promet pourtant des débits ultra-rapides et une faible latence. Alors, pourquoi ces fluctuations de réseau persistent-elles ? Le problème tient à l’architecture même de nos réseaux cellulaires.
Basés sur des cellules géographiques fixes, les réseaux actuels reposent sur des antennes d’émission-réception qui desservent chaque utilisateur selon sa position. Cette infrastructure atteint ses limites lorsque les utilisateurs se déplacent ou lorsque la densité des connexions augmente : débit insuffisant, coupures répétées, latence accrue. Or ces limites deviennent de plus en plus problématiques face à l’essor des objets connectés (IoT) – montres, capteurs médicaux, voitures autonomes… – et l’exigence croissante en matière de qualité de service.
Pour répondre à ces besoins, la recherche explore de nouvelles infrastructures, parmi lesquelles les réseaux sans cellule (cell-free). Plutôt que d’organiser les connexions autour de cellules fixes, les réseaux cell-free placent les utilisateurs au centre, en offrant une connectivité homogène grâce à la collaboration entre plusieurs antennes. Ce changement de paradigme ne vient pas sans défis techniques, auxquels se propose de répondre le projet PERSEUS. Deux professeurs d’IMT Atlantique, Catherine Douillard et Charbel Abdel Nour, sont co-porteurs pour l’Institut Mines-Télécom de ce projet dédié aux briques technologiques du PEPR Réseaux du Futur.
Une nouvelle approche centrée sur l’utilisateur
Dans les réseaux classiques, chaque cellule géographique a en son centre une station de base avec une antenne, qui sert tous les utilisateurs dans les limites bien définies de la cellule. Lorsqu’un utilisateur se déplace, il change de cellule et une autre antenne prend le relais pour le servir. Ce transfert, appelé handover, repose sur un échange d’informations entre les stations de base pour s’assurer que la connexion ne soit pas interrompue.
Avec ce processus, « si un utilisateur est très éloigné, en bordure de deux cellules, il subit souvent une dégradation de la qualité du signal », développe Charbel Abdel Nour, chercheur spécialisé dans les techniques de codage de canal et d’allocation de ressources. De même lorsque de nombreux utilisateurs tentent de se connecter simultanément. « Dans les deux cas, il faut plus de ressources temps-fréquence pour recevoir le débit dont on a besoin ».
Avec les réseaux cell-free, ces limitations disparaissent car l’utilisateur n’est plus rattaché à une antenne unique, mais peut être desservi par plusieurs antennes simultanément. En se combinant, celles-ci fournissent un signal optimal à moindre puissance. « Cette collaboration permet une couverture uniforme et continue, sans rupture de connexion », poursuit Abdel Nour. Catherine Douillard, experte des couches physiques des systèmes de communication, souligne un autre avantage clé : « Les réseaux cell-free permettent une gestion optimisée des ressources, qu’il s’agisse de spectre, de puissance ou de temps, tout en réduisant l’impact énergétique ». Cette efficacité est décisive pour subvenir aux besoins futurs d’un nombre accru d’objets connectés et d’utilisateurs.
Le défi du MIMO distribué
Pour concrétiser les réseaux cell-free, PERSEUS mise sur le MIMO distribué : une technologie clé dans laquelle plusieurs antennes collaborent pour concentrer la puissance de leurs signaux et limiter les interférences vers les utilisateurs. Or cette collaboration nécessite un échange supplémentaire de signalisation entre les antennes. Trouver le meilleur compromis entre la quantité d’information de signalisation échangée et le niveau d’interférences admissible pour une qualité de service visée représente donc un défi majeur.
« Nous travaillons sur des méthodes avancées de correction en réception et d’optimisation des ressources pour minimiser les effets indésirables », expose Charbel Abdel Nour. « Nous étudions notamment des techniques de modulation du signal, très robustes vis-à-vis des décalages en temps ou en fréquence de l’onde reçue, afin de pouvoir servir plusieurs utilisateurs simultanément. Ces techniques permettent d’augmenter la capacité du réseau sans en augmenter la consommation électrique. »
Contrairement à d’autres projets du PEPR qui explorent les fréquences millimétriques ou térahertz, PERSEUS se concentre sur des bandes de fréquences inférieures à 7 GHz. Or, s’il est possible, à très haute fréquence, de regrouper beaucoup d’antennes sur un seul site, à plus basse fréquence, celles-ci doivent être réparties sur plusieurs. « D’où l’intérêt du cell-free qui consiste à faire collaborer les antennes distribuées pour qu’elles pointent la puissance vers un seul endroit », argumente Catherine Douillard.
Des formes d’ondes au service de la synchronisation
Cependant, la mise en œuvre des réseaux cell-free reste encore largement théorique et soulève des défis majeurs en matière de synchronisation. « Dans un système distribué, lorsque plusieurs antennes desservent un utilisateur, leurs signaux arrivent souvent en décalage, du fait de leur distance respective ou encore de la présence d’obstacles sur le canal de propagation », développe Charbel Abdel Nour. Ces variations rendent difficiles la réception et le décodage des données, en particulier lorsqu’un grand nombre d’antennes collaborent. De même lorsqu’il faut synchroniser de très nombreux utilisateurs qui, chacun, transmettent une onde avec un retard propre.
Pour résoudre ce problème, les réseaux classiques s’appuient sur des échanges constants d’informations entre les antennes et les utilisateurs afin de synchroniser précisément les signaux. Une grande partie des données échangées sert à synchroniser les signaux plutôt qu’à transmettre des informations réellement utiles, réduisant l’efficacité globale du réseau. « Et plus il y a de transmissions, plus il faut échanger de données pour la synchronisation », complète Catherine Douillard.
PERSEUS explore donc des techniques pour réduire au maximum ces échanges, dont des formes d’ondes innovantes permettant de fonctionner en synchronisation relâchée – le récepteur est capable de synchroniser même avec de petits décalages dans l’arrivée des signaux – voire en asynchronisme, avec des décalages importants. « Ces solutions limitent les échanges d’informations inutiles entre les antennes et les utilisateurs, ce qui économise à la fois de la bande passante et de l’énergie », ajoute la chercheuse.
Des solutions technologiques entre exploration et adaptation
Enfin, PERSEUS mise également sur des technologies complémentaires comme les surfaces intelligentes reconfigurables (RIS), qui aident à façonner le canal radio pour améliorer la connectivité. Ces surfaces agissent comme des miroirs orientables qui réfléchissent de manière intelligente les signaux radio et les réacheminent vers les utilisateurs situés dans des zones mal couvertes. « Dans un stade par exemple, la connexion entre l’antenne relais et certains utilisateurs peut être obstruée par des murs ou des gradins. Les RIS redirigent alors les signaux de manière ciblée, améliorant la couverture et la qualité de service », illustre Charbel Abdel Nour. Ces technologies pourraient améliorer l’efficacité des réseaux tout en réduisant leur consommation énergétique. Cependant, elles font encore l’objet de nombreuses recherches, notamment sur les méthodes de fabrication reposant sur l’utilisation de métamatériaux.
L’ensemble des technologies utilisées dans les réseaux classiques est ainsi adapté et optimisé pour répondre aux nouveaux défis des réseaux cell-free. « Toutes les solutions sur lesquelles nous travaillons depuis des années – comme les formes d’ondes, la gestion multi-utilisateurs ou encore les codes correcteurs d’erreurs – trouvent dans PERSEUS une application directe, mais dans un cadre qui nécessite de les réinventer », conclut Charbel Abdel Nour.