Confiance et identités dans le numérique
Cet article fait partie de notre dossier consacré à la confiance, publié à l’occasion de la sortie du cahier de veille de la Fondation Mines-Télécom : « Les nouveaux équilibres de la confiance : entre algorithmes et contrat social ».
[divider style= »normal » top= »20″ bottom= »20″]
Que signifie « faire confiance » aujourd’hui ? La technologie redéfinit la notion de confiance en mettant la question de la transparence de l’identité sur le devant de la scène. Mais pour Armen Khatchatourov, philosophe à Télécom École de Management et membre de la chaire Valeurs et Politiques des informations Personnelles de l’IMT, la question est plus profonde, et cette approche problématique. Elle témoignerait en effet de la réduction de la confiance à la simple gestion du risque dans nos interactions sociales. Une nouvelle perception qu’il serait bon de questionner, tant elle ignore la complexité de ce qu’est réellement la confiance.
Dans nos sociétés numérisées, la question de la confiance semble très liée à la transparence des identités. Pour faire confiance, faut-il savoir qui est derrière notre écran ?
Armen Khatchatourov : Ramener la confiance à la question de l’identité me paraît très réducteur. C’est une association qui est de plus en plus présente dans notre société, et qui témoigne d’un glissement de sens. La confiance, ce serait pouvoir vérifier l’identité de nos interlocuteurs sur les réseaux numériques — ou du moins leur légitimité — par une validation institutionnelle. Celle-ci pourrait aussi bien être étatique que technologique. Mais c’est considérer que la confiance est uniquement une évaluation du risque que l’on prend dans une interaction, et qu’augmenter la confiance c’est avant tout minimiser le risque. Or cette approche me semble très réductrice dans la mesure où la confiance n’est pas un concept aussi homogène, et revêt bien d’autres aspects.
Quelles sont les autres dimensions de la confiance ?
AK : Les travaux du sociologue Niklas Luhmann démontrent qu’il y a une autre forme de confiance, qui s’enracine dans les interactions de proche en proche. Il s’agit typiquement de la confiance dans le système social dans son ensemble, ou encore de la confiance que nous construisons avec nos amis ou notre famille. Un enfant fait confiance à ses parents pour des raisons qui sont autres qu’un calcul du risque. Luhmann utilisait les deux mots anglais « trust » et « confidence » qui se traduisent tous deux en français par le mot confiance. Pour lui, la nuance était réelle : « trust » correspond à ce type de confiance qui, à son extrémité, peut être décrit comme une pure gestion du risque, quand « confidence » est plus propre aux interactions sociales de proche en proche, à une forme d’adhésion à la société. Là où il apparaît que les choses ne sont pas homogènes, c’est que pour une même relation, les deux termes peuvent coexister. Je serais plus dans confidence avec mes amis. Mais si je monte une start-up avec eux, la confiance évoluera aussi vers sa forme trust. L’inverse peut également être vrai, bien entendu, lorsque les interactions répétées conduisent à une forme d’adhésion à un système social.
La forme « trust » de la confiance prend-elle le dessus sur la forme « confidence » ?
AK : Malheureusement, cette différence entre les deux formes de la confiance a tendance à se perdre dans notre société, et il y a un glissement vers une confiance uniformisée. Nous définissons de plus en plus la confiance par des recommandations agrégées sous une forme de note sur une application ou un service, ou par un label. La théorie économique a thématisé cela à travers la notion de réduction d’asymétrie d’information. On voit ici le cadre conceptuel sous-jacent et la notion du risque avant tout économique qui lui est associée. Soit dit en passant, cette confiance-trust que nous accordons est basée sur des mécanismes opaques. Il y a aujourd’hui une part algorithmique que nous ne connaissons pas dans les recommandations qui nous sont faites. Le mécanisme d’établissement de cette confiance est donc complètement différent de la façon dont nous apprenons à faire confiance à un ami.
La transparence de l’identité serait-elle donc un faux problème lorsqu’il s’agit de débattre de la confiance ?
AK : Certains peuvent être réticents au pseudonymat. Mais un pseudonyme n’est pas une fausse identité. C’est simplement une identité que l’on sépare de l’identité civile, définie par notre carte d’identité. Dans toutes les relations sociales classiques, vous êtes en un certain sens pseudonyme. Lorsque vous rencontrez quelqu’un dans un bar et que vous nouez une relation amicale ou amoureuse, vous ne vous définissez pas par votre état civil, et vous ne présentez pas votre carte d’identité. Pourquoi faudrait-il qu’il en soit autrement sur les usages numériques ?
N’y a-t-il pas des cas où il reste nécessaire de valider l’identité de nos interlocuteurs ?
AK : Si bien sûr. Lorsque vous vendez ou achetez une maison vous passez par un notaire qui est un tiers de confiance. Mais là n’est pas la question. Le vrai problème, c’est que nous avons de plus en plus une tendance naturelle à être dans une attitude de méfiance. Se poser la question de l’identité de la personne qui nous prend en covoiturage sur Blablacar illustre ce glissement : personne ne demande la carte d’identité du conducteur lorsqu’il fait de l’auto-stop. Ce qui ne paraissait pas problématique il y a quelques années le devient. Et dire aujourd’hui que la transparence n’est pas forcément gage de confiance devient inaudible, alors que c’est justement un sujet à questionner.
Pourquoi faut-il questionner ce glissement ?
AK : Il faut ici repartir de l’analyse, approche dont le philosophe Michel Foucault a fait le nerf de son travail, de ce qui, à telle ou telle époque historique, semblait aller de soi, aux mécanismes sous-jacents aux représentations admises pour dominantes. Il a surtout questionné le passage d’une construction à une autre, leur évolution historique. De même ici, nous sommes en présence d’un régime nouveau selon lequel quelque chose comme une « société » est possible à travers les interactions sociales. Ce glissement dans les thèmes de l’identité et de la confiance témoigne de l’évolution de la société dans son ensemble, de l’évolution des liens sociaux, et ce n’est pas une simple question de gestion des risques, de sécurité ou d’efficacité économique.
Cette crise de la confiance centrée sur l’identité n’est-elle pas paradoxale dans un contexte de protection des données personnelles, qui sont par ailleurs de plus en plus nécessaires aux nouveaux services numériques ?
AK : Tout à fait, et c’est un paradoxe qui illustre bien les tensions auxquelles est soumise la notion d’identité. D’un côté il y a une exigence de fournir des données pour optimiser les services et s’afficher comme utilisateur de confiance auprès des autres usagers. De l’autre côté, il y a une volonté de se protéger, voire de se replier sur soi. Les deux mouvements sont contradictoires. C’est toute la complexité du sujet : il n’y a pas une tendance à sens unique, et une fois pour toutes. Nous sommes tiraillées entre d’un côté une exigence et un désir de fournir nos données personnelles — désir car les utilisateurs de Facebook aiment partager des données sur leurs profils — et, d’un autre côté, un désir et une exigence également de les protéger — exigence car nous y sommes aussi poussés par les discours institutionnels. Ma position n’est évidement pas contre ces discours institutionnels. On peut penser ici au GDPR qui, au moment précis où nous parlons, est plus que bienvenu pour assurer une certaine protection des données personnelles. Mais il convient néanmoins de comprendre les tendances sociales plus générales dont ce discours institutionnel est un des éléments. Ces tensions dans lesquelles l’identité s’inscrit ont inévitablement des répercussions sur la manière dont nous nous représentons la confiance.
Comment la confiance s’en trouve-t-elle impactée ?
AK : La chaire Valeurs et politiques des informations personnelles dont je fais partie a mené une large enquête avec Médiamétrie sur ces questions de confiance et des données personnelles. Nous avons évalué séparément la volonté des usagers de protéger leurs données, et leur sentiment d’impuissance à le faire. Les résultats montrent un sentiment de résignation d’environ 43 % des interrogés. Cette partie de l’enquête est une réplication d’une étude réalisée en 2015 aux Etats-Unis par Joseph Turow et son équipe, où ils obtenaient un résultat de 58 % de résignés. Cette résignation se traduit par l’acte de donner ses informations personnelles non pas par recherche d’un avantage économique, mais par sentiment d’incapacité à faire autrement. Ce résultat pose inévitablement la question de savoir où est la confiance dans ce rapport. Il s’agit clairement d’une attitude qui vient contredire les suppositions de certains économistes selon lesquels l’acte de fournir ses données personnelles est uniquement motivé par un équilibre coûts/avantages que l’individu peut en retirer. Cette résignation montre la tension qui anime également le concept de confiance. D’une certaine façon, ces utilisateurs ne sont désormais plus ni dans le trust, ni dans la confidence.


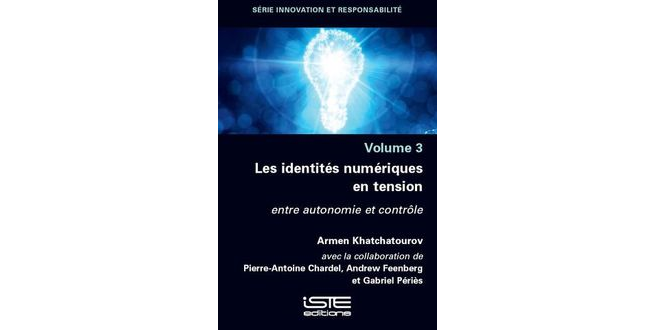

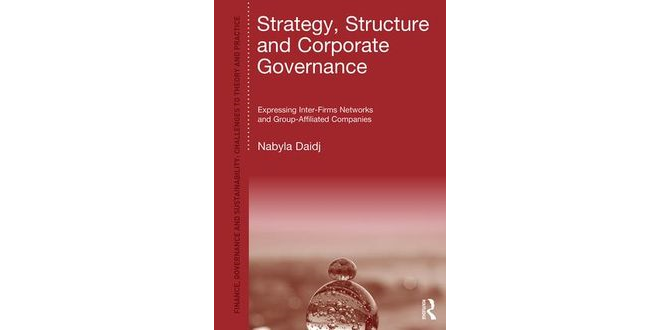




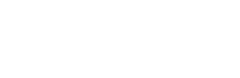


Trackbacks (rétroliens) & Pingbacks
[…] juillet : interview de Armen Khatchatourov «Confiance et identités dans le numérique", blog « Recherche » de l’Institut […]
[…] Confiance et identités dans le numérique […]
[…] Confiance et identités dans le numérique […]
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !