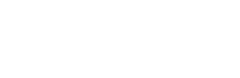En France métropolitaine, les eaux souterraines représentent près des deux tiers de la consommation d’eau potable, et plus du tiers de celle du monde agricole. Pourtant, selon un bilan environnemental du service des données et études statistiques (SDES), en charge des statistiques publiques de l’énergie, des transports, du logement et de l’environnement, en 2022, un peu moins de 70 % des eaux superficielles et souterraines présentaient un bon état chimique. En dépit des efforts des dernières décennies, la pollution de l’eau reste une source majeure de dégradation de l’environnement, avec un impact considérable sur les écosystèmes, mais aussi sur la santé humaine. « Le problème de l’eau est crucial pour la planète, ainsi que pour tous les êtres vivants. Plus une eau est polluée, plus il est difficile de la boire ou de l’utiliser pour l’agriculture », résume Yves Andres, Professeur à IMT Atlantique et responsable du département des systèmes énergétiques et environnement.
Depuis bientôt six ans, ce dernier participe activement aux côtés de Sarah Ghaffari, Maître-assistante au département interdisciplinaire de sciences sociales, au projet Horizon Europe NINFA (pour « TakiNg actIoN to prevent and mitigate pollution oF groundwAter bodies », GA 101081865). Lancé en mars 2021 sous la coordination du centre technologique espagnol LEITAT, ce projet vise à prévenir et réduire la pollution des eaux souterraines dans plusieurs régions d’Europe. Il est divisé en sept volets de recherche qui couvrent aussi bien des problématiques scientifiques, que juridiques et logistiques.
Les scientifiques d’IMT Atlantique se concentrent particulièrement sur le développement de systèmes destinés à l’assainissement des eaux en dernière étape, c’est-à-dire après les traitements primaires et secondaires, déjà réalisés dans les stations d’épuration. Cette dernière étape, très avancée, a pour objectif d’éliminer les résidus toxiques et agents pathogènes qui pourraient subsister dans ces eaux. « Un de nos buts est de promouvoir, au travers de ce projet, l’installation généralisée d’un traitement tertiaire, qui serait utilisé partout et en permanence », complète Yves Andres.
Lutter contre les polluants émergents
Ces innovations techniques cherchent avant tout à traiter les contaminants dits « émergents ». Ce sont des substances chimiques ou biologiques comme les résidus pharmaceutiques, les hydrocarbures, les microplastiques, ou encore des bactéries antibiorésistantes qu’on peut retrouver dans les eaux, même après leur passage en station d’épuration.
Certains résidus de produits pharmaceutiques, comme la carbamazépine ou encore le sulfaméthoxazole ─ respectivement un antiépileptique et un antibiotique ─ sont ainsi très fréquemment détectés dans des échantillons d’eau. Comme ils sont difficilement biodégradables, il faut une intervention supplémentaire pour les éliminer. « Le projet se concentre sur ces molécules précisément, car elles sont présentes dans des normes sur la qualité des eaux. Elles font donc office d’indicateur fiable pour déterminer le niveau de pollution d’une eau », détaille Yves Andres.
Quant aux bactéries antibiorésistantes, elles représentent un enjeu de santé majeur. Ces microorganismes ont développé des gènes de biorésistance, à force d’être en contact avec des antibiotiques dans le corps des êtres vivants. Leurs capacités d’adaptation et leur résilience les rendent difficiles à éliminer. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) prévoit par ailleurs une surmortalité accrue de plusieurs millions de personnes dans le monde d’ici 2050 des suites de l’antibiorésistance. Pour travailler sur l’élimination de ces bactéries, les équipes d’IMT Atlantique ont choisi comme modèle de référence Escherichia coli BLSE, une souche antibiorésistante souvent présente dans les eaux usées traitées.
Une solution de traitement de l’eau « en filière »
Pour faire disparaitre ces microorganismes et résidus toxiques persistants dans les eaux usées traitées, une filière d’assainissement tertiaire a été mise en place et testée en laboratoire. Celle-ci comporte trois étapes de traitements, qui s’effectuent de manière successive.
Dans une première étape de filtration, l’eau s’écoule très lentement au travers d’une couche de sable fin, qui a pour but de retenir une grande partie des matières en suspension. Ensuite, les scientifiques provoquent une réaction photochimique (faisant appel à de la lumière), appelée photo-Fenton. En exposant du fer à des rayons UV, des agents oxydants très réactifs se forment dans l’eau, capables de décomposer les polluants organiques. Enfin, dans la troisième et dernière partie du procédé, l’eau passe au travers de charbons actifs qui vont absorber efficacement les dernières molécules polluantes, en les attirant et en les fixant à leur surface.
Chacune de ces trois briques technologiques est plus ou moins spécifique à certains polluants : le filtre à sable retient en priorité les microplastiques, la photo-Fenton parvient à éliminer les bactéries antibiorésistantes et une partie des micropolluants organiques, et enfin le charbon absorbe les micropolluants organiques.
Adapter la technique à la société
Si l’ensemble de ce système a été testé et validé d’un point de vie technique au LEITAT, à Terrassa en Catalogne, le projet NINFA inclut un volet sociotechnique pour évaluer l’acceptabilité de l’ensemble des technologies étudiées. La sociologue Sarah Ghaffari travaille justement sur ces aspects et estime que les technologies seules ne sauraient s’implanter dans la société et fonctionner avec efficacité sans une analyse des territoires et des personnes qui les peuplent. « Quand une technologie est développée, elle n’apparaît pas sur un territoire en s’imposant à la société : il doit y avoir une adaptation mutuelle », soulève-t-elle. « Une technologie ne peut être au point tant qu’elle n’a pas rencontré son territoire et les personnes qui l’habitent. C’est pourquoi l’acceptabilité doit se comprendre dans les deux sens : appropriation sociale et flexibilité technologique. »
Depuis de nombreuses années, scientifiques et spécialistes s’accordent sur le fait qu’une méthodologie intégrant à la fois les sciences sociales et les sciences exactes enrichit considérablement la qualité d’un projet. En reliant l’innovation technologique aux questionnements de société, cette approche interdisciplinaire apporte une compréhension plus globale des enjeux d’un projet, au-delà donc des seuls aspects techniques et technologiques. « La technologie reste une production humaine, à destination d’autres humains. La question sociale est toujours présente, sous une forme ou une autre », souligne Sarah Ghaffari.
Une campagne de sensibilisation sur les enjeux liés à l’eau
Avec un périmètre d’action sur tout le continent européen, les solutions techniques du projet NINFA doivent donc s’adapter aux différents territoires, ainsi qu’à leurs ressources, leurs cultures et leur population. En 2024 et 2025, Sarah Ghaffari a ainsi mené des recherches et des enquêtes auprès des habitants et habitantes de deux territoires, l’un en Murcie, en Espagne, et l’autre en Pays de la Loire, en France. « L’objectif était de comprendre les connaissances et les représentations que ces personnes pouvaient avoir sur le sujet de l’eau et des problématiques associées, avant que la solution technique n’apparaisse sur le territoire et s’implante dans la société », explique-t-elle.
Les résultats de cette enquête exploratoire et générique serviront au développement d’un jeu de téléphone mobile, qui prendra la forme d’un quiz autour des grands thèmes liés aux enjeux de l’eau. « L’objectif de ce jeu est de sensibiliser les gens aux enjeux de la protection de l’eau. Car, pour que des dispositifs techniques soient vus comme des solutions, encore faut-il qu’il y ait une représentation commune du problème auquel ils sont susceptibles de répondre », ajoute la sociologue. En combinant innovation technique et compréhension sociale, NINFA esquisse ainsi une voie durable pour préserver une ressource vitale qui concerne chacun et chacune de nous.