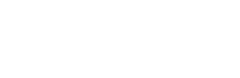À quoi correspondent les limites planétaires ?
Natacha Gondran : Les limites planétaires sont un cadre scientifique élaboré en 2009 par un groupe de scientifiques issus de différentes disciplines des sciences de l’environnement, réunis autour de Johan Rockström. Ce cadre vise à identifier les processus essentiels qui régulent la stabilité et la résilience du système Terre. Les limites planétaires, au nombre de neuf, sont : le changement climatique (qui prend en compte la concentration de CO₂ et le forçage radiatif) ; l’érosion de la biodiversité ; l’acidification des océans ; l’appauvrissement de la couche d’ozone ; le cycle de l’eau douce (modifications des précipitations, sécheresses, inondations), le cycle de l’azote et du phosphore (pollution des sols et des eaux par l’agriculture intensive), le changement d’utilisation des sols (déforestation, urbanisation), l’introduction d’entités nouvelles (pollution chimique, plastiques, produits toxiques) ; et enfin la pollution atmosphérique par les aérosols. Pour chaque limite, une « variable de contrôle » et une valeur seuil sont estimés : il s’agit des « frontières planétaires » qui garantissent de maintenir des conditions favorables à l’habitabilité de notre planète.
En effet, depuis environ 12 000 ans, la Terre est dans un état relativement stable, que l’on appelle l’Holocène. Cependant, les activités humaines exercent aujourd’hui une pression telle que certaines de ces conditions de stabilité risquent de basculer. Si ces variables-clés dépassent le seuil fixé, le système pourrait entrer dans un état beaucoup plus incertain, voire dangereux pour l’humanité. Ces seuils n’étant pas connus à l’avance, des valeurs, aussi appelées « frontières », sont définies pour garder une marge de sécurité et éviter d’entrer dans une « zone à hauts risques » qui verrait les conditions d’équilibre actuelles du système Terre être bouleversées.
Ces limites font-elles consensus pour décrire l’état de la planète ?
NG : Comme souvent en sciences, les limites planétaires ne sont pas totalement consensuelles. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), notamment, n’en parle pas explicitement dans ses rapports. Leurs raisons sont scientifiques, d’une part, car tous les indicateurs ne font pas l’unanimité dans la communauté scientifique, certains climatologues estimant que le climat change progressivement, sans faire l’objet de seuils de bascule. Mais aussi politiques. En effet, certains décideurs craignent qu’annoncer qu’il y a une limite déjà dépassée risque d’être démobilisateur du point de vue de l’action climatique.
Toutefois, suite à l’Accord de Paris et à la décision des États signataires de limiter le réchauffement climatique à +2 °C, le GIEC a rédigé un rapport sur les différences au niveau planétaires entre un réchauffement de +1,5 °C et de +2°C. Entre les lignes, on peut y lire qu’entre ces deux valeurs-seuils, les conséquences seraient très différentes : à +2 °C, elles deviennent totalement ingérables pour l’humanité. C’est donc une frontière définie implicitement.
Il s’agit en outre d’un cadre en constante évolution, prenant en compte des disciplines variées : climatologie, biologie, géographie, mais aussi, depuis 2023, les sciences sociales. À ce sujet, un nouveau cadre défini en 2023, moins médiatisé pour l’instant, fixe des limites « sûres » et « justes ». Celles-ci intègrent les enjeux de justice sociale, en prenant en compte les vulnérabilités des populations les plus exposées.
Quel est l’état actuel des limites planétaires ?
NG : Les études récentes montrent que plusieurs de ces frontières ont déjà été franchies. Lors de leur définition en 2009, trois frontières étaient déjà préoccupantes : le changement climatique, l’érosion de la biodiversité et le cycle de l’azote. Quelques années plus tard, en 2015, le phosphore et l’utilisation des sols ont également dépassé des niveaux critiques. Et plus récemment, en 2023, deux nouvelles frontières ont été reconnues comme dépassées : le cycle de l’eau douce (dont la variable de contrôle a changé entre 2015 et 2023) et l’introduction d’entités nouvelles. Dans la publication de 2023, seules la charge en aérosols et l’acidification des océans restaient en deçà des seuils critiques, bien que pour cette dernière, la frontière est en passe d’être franchie.





 Je ne pense pas que le rôle des scientifiques soit de ménager les citoyens, mais plutôt de les informer de la réalité du contexte climatique et écologique, à toutes les échelles.
Je ne pense pas que le rôle des scientifiques soit de ménager les citoyens, mais plutôt de les informer de la réalité du contexte climatique et écologique, à toutes les échelles.