Chaque 1er avril, les canulars font sourire ou piègent les plus crédules. Mais à l’ère du numérique, la diffusion d’informations trompeuses, massive et ultra-rapide, ne relève plus tellement de la farce bon enfant. Dans un contexte européen où les menaces sur les démocraties se renforcent et où des périodes électorales déterminantes se profilent dans plusieurs pays, l’information joue un rôle plus décisif que jamais. Fonction vitale des régimes démocratiques, l’information peut, si elle est instrumentalisée, altérer profondément le débat public et la confiance envers les institutions. Or sa circulation, autrefois contrôlée par des médias institutionnels, est aujourd’hui décentralisée et modelée par des plateformes numériques aux algorithmes opaques, transformant en profondeur les espaces d’expression et de délibération des sociétés démocratiques.
Lauréat d’un appel ANR France 2030, le projet DemoCIS (Démocraties, citoyenneté et institutions face aux transformations des espaces publics) s’attelle à comprendre ces mutations et à expérimenter des solutions. L’Institut Mines-Télécom, au travers d’IMT Atlantique et d’IMT Business School (IMT-BS), est investi dans ce programme interdisciplinaire, qui prolonge de nombreux travaux menés depuis plusieurs années dans les deux écoles. L’objectif : proposer des outils d’analyse et d’actions pour lutter plus précisément contre la polarisation et le « désordre informationnel ». Un terme soigneusement choisi, comme le signale Inna Lyubareva, Professeure à IMT Atlantique et coordinatrice du projet pour l’IMT : « On parle beaucoup des fake news, mais elles ne représentent qu’une partie du problème. Aujourd’hui, qu’il s’agisse de désinformation, intentionnelle ou non, ou de mal-information – c’est-à-dire la diffusion d’informations vraies mais sorties de leur contexte – nous faisons face à une diversité de forme des perturbations informationnelles. »
Il ne s’agit donc pas simplement d’identifier des contenus trompeurs, mais d’appréhender plus largement la manière dont un écosystème complexe structure et amplifie les dynamiques informationnelles. Cette analyse ne se réduit pas non plus aux réseaux sociaux, mais intègre tout un spectre d’acteurs, qui vont des plateformes numériques aux médias, aux créateurs et créatrices de contenu, citoyens et citoyennes, instances de régulation et responsables politiques, en passant par les évolutions technologiques majeures comme l’IA générative. DemoCIS vise ainsi à comprendre comment l’écosystème des désordres informationnels se construit, à développer des outils de mesure, pour observer son évolution, et à proposer des réponses adaptées.
Cartographier et mesurer l’écosystème du désordre informationnel
Pour comprendre les mécanismes de diffusion et d’amplification du désordre informationnel, DemoCIS va donc développer des outils de modélisation afin d’analyser dynamiquement ces phénomènes. Christine Balagué, Professeure à IMT-BS et spécialiste des plateformes numériques et de l’IA, soulève que l’un des défis majeurs réside dans l’absence de vision systémique de l’environnement informationnel. « Bien sûr, nous ne partons pas de zéro : les phénomènes de désordre informationnel – liés à la création de contenus et à leur amplification par les médias, les algorithmes, les bots, jusqu’à la réception par des consommateurs d’information et leur comportement de partage … – sont déjà bien documentés dans la littérature. »
Ce programme s’inscrit en outre dans le prolongement de travaux menés par différentes équipes de l’IMT depuis plusieurs années, notamment à travers le projet ANR Pluralisme de l’information en ligne et le projet européen MeDeMap (pour Mapping Media for Future Democracies) d’IMT Atlantique, la chaire pionnière « Réseaux sociaux : création de valeur économique et sociale » lancée en 2014 par Christine Balagué, ou encore le réseau Good In Tech que la chercheuse pilote depuis 2019 et qui a coorganisé, début 2023, une conférence internationale sur la nouvelle régulation européenne Digital Services Act (DSA).
Les effets du DSA, concomitants à l’émergence de technologies comme l’IA générative, ou de nouveaux acteurs comme BlueSky, démontrent la nécessité d’une vision systémique et dynamique des désordres informationnels et de leur environnement telle que le prévoit DemoCIS. Le projet adopte pour cela une approche innovante et interdisciplinaire, combinant à la fois des méthodes des sciences humaines et sociales avec celles des sciences des données, des approches qualitatives et des approches quantitatives. « Nous réunissons d’ores et déjà des collègues de différentes disciplines, pour identifier les bons exemples et évènements à analyser, et comprendre les logiques de propagation du désordre informationnel », explique Christine Balagué. « Il faudra ensuite réfléchir à des critères de mesure quantitatifs qui ne sont pas du tout développés à ce jour. C’est très nouveau de penser le désordre informationnel comme un écosystème, qui de plus, est mesurable », complète la chercheuse.
Des dynamiques qui varient selon les contextes historiques et territoriaux
Bien qu’il n’ait pas encore été officiellement lancé, le projet alimente donc déjà de nombreuses réflexions. « Nous devons nous accorder assez tôt sur les formes de désordre informationnel à étudier et les exemples concrets à examiner, car ils détermineront les méthodes de collecte et les données à analyser. Sur les réseaux sociaux, il est de plus en plus compliqué de récupérer de l’information par exemple », développe Inna Lyubareva. « En France, les exemples concrets d’événements ayant généré du désordre informationnel ne manquent pas : le mouvement des gilets jaunes, la crise Covid, les émeutes après la mort de Nahel… Chacun de ces exemples est relié à une période donnée pendant laquelle la désinformation et la mal-information ont largement circulé. »
De là, les chercheuses espèrent identifier les éléments structurels de la mise en circulation et de la propagation du désordre informationnel. Dans leurs radars : les acteurs impliqués – plateformes numériques, influenceurs ou influenceuses – les technologies – IA générative, algorithmes de recommandation – les médias d’information, ou encore le cadre politique et social qui façonne la réception par le public. Inna Lyubareva attire également l’attention sur la diversité des dynamiques locales. « Le fonctionnement démocratique n’est pas homogène partout, donc les perturbations informationnelles varient selon les territoires et les contextes sociopolitiques. Le fait de pouvoir s’appuyer sur des équipes de recherche réparties dans différentes régions françaises a d’ailleurs été un atout essentiel dans notre programme scientifique », précise-t-elle.
Décrypter, anticiper et protéger l’espace informationnel
Loin d’être une simple initiative d’observation, DemoCIS projette de produire des outils concrets et pérennes pour chacun des grands défis qui le structurent. Pour lutter contre le désordre informationnel, qui constitue l’un de ces défis, un baromètre de la démocratie ou encore une plateforme dédiée au suivi et à l’analyse des risques informationnels ont été proposés. « La création d’indicateurs et, en particulier, le développement à long-terme de systèmes de détection et d’alerte précoce, sont des objectifs très ambitieux », souligne Inna Lyubareva. Les travaux en sciences sociales autour des phénomènes informationnels sont en effet souvent critiqués pour leur retard sur leur objet d’étude : « Il faut du temps pour la collecte et l’analyse des données, et bien souvent, à la parution de nos livrables, ils ne sont déjà plus d’actualités », déplore la chercheuse.
Pour mener à bien ces travaux, l’IMT, impliqué dans ce défi des désordres informationnels aux côtés des universités de Lille, Cergy Paris, Grenoble Alpes et Jean Moulin Lyon 3, mobilisera une vingtaine de chercheurs et chercheuses, en plus du recrutement de doctorants et post-doctorants. DemoCIS s’appuiera ainsi sur une expertise interdisciplinaire de haut niveau pour développer des modèles et des outils capables d’anticiper la propagation des phénomènes informationnels et d’identifier les zones de l’écosystème particulièrement vulnérables au désordre. En proposant ainsi des solutions adaptées aux évolutions rapides du paysage informationnel, le projet devrait répondre aux besoins des instances de régulation comme l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), ou accompagner la mise en œuvre du DSA. « Nous espérons aussi que le programme servira à outiller les producteurs de contenus et le grand public, pour les aider à mieux cerner le paysage médiatique et les risques qui y émergent », conclut Inna Lyubareva.






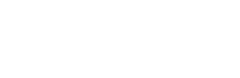

 Canva pro
Canva pro