Les cerisiers de Fukushima
Tribune rédigée par Franck Guarnieri, Aurélien Portelli, et Sébastien Travadel, chercheurs à Mines ParisTech.
La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.
[divider style= »normal » top= »20″ bottom= »20″]
[dropcap]L[/dropcap]’accident de Fukushima paraît aujourd’hui intégré à notre imaginaire comme un souvenir traumatisant, une date de commémoration au mois de mars nous rappelant notre fragilité face à la démesure des forces naturelles. Huit ans déjà qu’un séisme sans précédent a secoué le Tohôku et que des vagues de près de vingt mètres ont balayé le site de Daiichi.
En Occident, au-delà de l’immédiateté de l’événement, on a vu dans ses conséquences démentielles une rupture dans l’histoire : contamination de vastes territoires autour de la centrale, déplacement de dizaines de milliers de personnes, destruction d’activités économiques, faillite technologique d’une grande puissance, renforcement du discrédit jeté sur les institutions japonaises, mise à l’arrêt du parc nucléaire nippon pour inspection et recours massif aux énergies fossiles ; et aussi, audits à l’échelle internationale de la mise en œuvre des normes de sûreté, remise en cause de la filière dans certains pays…
Fukushima a également été interprété comme un « jumeau » de Tchernobyl, réitération du « mal » radioactif produit par la démesure industrielle qui avait creusé le tombeau de l’incurie soviétique.
7 ans après : Fukushima, affaire classée ? https://t.co/b6W7iQgLuF pic.twitter.com/oSZ4ffrwAt
— The Conversation France (@FR_Conversation) March 10, 2018
Une autre vision de la catastrophe
Dans l’imaginaire japonais cependant, la rupture catastrophique ne renvoie ni à une brisure irréparable, ni à un refoulement dans une éternelle répétition du même. L’apocalypse made in Japan « porte en germe un avenir qu’il revient aux hommes de faire lever », souligne l’historien Jean‑Marie Bouissou dès avril 2011.
Au Japon, la catastrophe s’ouvre sur une renaissance, dans un rapport spécifique au temps. La nécessité de réexaminer l’événement sous cet angle nous est apparue de manière spectaculaire lors de notre visite de la centrale accidentée en mars 2017.
Sur le terrain, le chantier de démantèlement et de décontamination, programmé sur plusieurs décennies, confronte les équipes à des défis technologiques inouïs. Il faut continuer de refroidir les réacteurs et les piscines, retirer les combustibles dégradés, contenir les rejets en traitant les eaux radioactives, créer de nouveaux moyens de stockage des boues contaminées et des déchets à une échelle inédite, identifier les éléments des combustibles fondus à l’aide de petits robots.
L’une des réalisations les plus ambitieuses est la construction d’un mur de glace autour des réacteurs pour isoler les eaux contaminées. Les mesures de radioactivité, affichant parfois des valeurs importantes, sont à la vue de tous et omniprésentes sur le site, où plus de six mille personnes œuvrent quotidiennement pour maîtriser les installations, toujours soumises au risque de séisme et de tsunami.
En circulant au plus près des réacteurs détruits, nous découvrons un site en pleine effervescence, lieu d’une reconfiguration des rapports entre l’homme, la nature et la technologie. Autour de nous s’étend un milieu artificialisé à l’extrême. La végétation a disparu et le béton a entièrement recouvert les collines, dans l’espoir de réduire la radioactivité des sols.
Pourtant, au cœur de ce paysage d’un autre monde, nous apercevons des arbres que les décontamineurs n’ont pas coupés : ce sont les cerisiers de Fukushima, alors en pleine fleuraison. Leur présence nous surprend et nous le faisons remarquer à l’ingénieur qui nous accompagne. Celui-ci nous précise que ces arbres ne seront pas retirés du site, alors même qu’ils obstruent le chantier et la circulation des équipements de décontamination. C’est que les travaux d’ingénierie menés à Daiichi ne se résument pas seulement à une « réparation » de la catastrophe ni à une restitution des lieux à leur état original.
Hommage à Masao Yoshida, le directeur de la centrale de Fukushima, mort le 9 juillet 2013 https://t.co/g3VifcQopn pic.twitter.com/tdAvUC1BFK
— The Conversation France (@FR_Conversation) July 9, 2018
La symbolique des cerisiers au Japon
Pour les Japonais, les fleurs de cerisier constituent un polysème. D’abord reliées à la force de vie dans le Japon ancien, de nouvelles symboliques ont émergé.
À partir de la période Heian (794-1185), la chute des fleurs de cerisier renvoie au pathos de l’éphémère. Entre les VIIIe et IXe siècles, l’esthétique de ce végétal devient également pour les Japonais le symbole de leur identité et de leur sentiment d’appartenance collective. Sous l’ère Meiji (1868-1912), la fleur de cerisier est associée à l’idéologie nationaliste promouvant la mort pour le roi, l’empereur, incarnation de la patrie. Cette symbolique atteint son paroxysme durant la guerre du Pacifique, où les fleurs de cerisier sont utilisées pour nommer des corps d’armée et décorer les avions pilotés par les kamikazes.
Aujourd’hui encore, le cerisier occupe une place importante dans la culture nippone, malgré la signification funeste qu’il a eue durant la Seconde Guerre mondiale. L’écrivain Haruki Murakami explique à quel point les Japonais apprécient le spectacle fugace de la floraison des cerisiers, et se demande si les catastrophes n’influencent pas en quelque sorte cette manière de penser :
« Tout au long de l’histoire, les Japonais ont survécu à tous les désastres qui nous sont tombés dessus. Nous les avons acceptés comme des événements dans un certain sens inévitables, qui se combinent pour surmonter les dommages qu’ils ont infligés. Ainsi, il est possible que ces expériences aient en quelque sorte influencé notre sensibilité esthétique. »
Le cerisier reflète donc en partie l’âme des Japonais ; il participe à un imaginaire temporel que nous associons à la « logique d’actualisation ». Pour expliciter cette notion, remarquons qu’en Occident, les objets exposés dans des musées sont définitivement extraits du quotidien pour être donné à voir à travers leur valeur historique. Rien de tel au Japon. Ainsi, les trésors de Shôsôin sont uniquement montrés lors d’une exposition annuelle et restent invisibles le reste du temps. Ces objets sont exhibés non pas pour représenter le passé, mais pour montrer qu’ils sont toujours dans le présent.
De même, les palais et certains temples de Kyôto ne s’ouvrent que périodiquement, pour signifier que ces bâtiments sont encore utilisés ou habités. Autre illustration de cette logique avec le Meiji-mura : ce musée en plein air rassemble plus de soixante constructions de l’ère Meiji, transportées sur place et reconstruite à l’identique. Ces bâtiments représentent une modernité qui est à l’origine étrangère au Japon : « la matérialisation du passé dans un espace isolé fait sentir que le passé n’est pas antérieur au présent, mais qu’il est ailleurs », souligne à ce propos Masahiro Ogino dans son article « La logique d’actualisation. Le patrimoine et le Japon ».
La logique d’actualisation est ici assurée par la présence de certaines constructions, qui occupent les mêmes fonctions qu’autrefois : le visiteur peut envoyer une carte postale depuis un ancien bureau de poste ou utiliser certaines locomotives à vapeur pour se déplacer.
FR • #Source1910 • Dr Emiko Ohnuki-Tierney, s’est demandée: "Comment devient-on Kamikaze ?" Demain, au Asian Centre de UBC, elle expliquera comment, pendant la Seconde Guerre mondiale, les élites japonaises ont mis le beau au service du mal • https://t.co/wOAilfkl3w #WWII pic.twitter.com/5FGGFKU93J
— The Source/La Source (@thelasource) November 22, 2018
Fabriquer du sens pour réparer le monde
Afin de saisir le rapport entre cet imaginaire du temps et l’activité sur le site de Daiichi, revenons au début de l’électronucléaire au Japon, dont le développement a été assuré par l’introduction de technologies étrangères.
Le premier réacteur de l’archipel est de type Magnox, de conception britannique. Construit dans la centrale de Tokai, il est raccordé au réseau électrique en juillet 1966. La construction du premier réacteur à eau bouillante (REB) de Fukushima Daiichi est quant à elle supervisée par la firme américaine General Electric. Il est mis en service en mars 1971.
La technologie nucléaire au Japon provient par conséquent d’un « ailleurs », comme la modernisation du pays sous l’ère Meiji était d’origine occidentale. Pour autant, la technologie à Daiichi n’a pas à être déplacée dans un lieu muséifié comme au Meiji-mura. Elle a été détruite et il faut en produire une nouvelle pour démanteler le site. Mais là encore, passé et présent s’articulent dans une logique d’actualisation symbolisée par les cerisiers : leur maintien à tout prix sur le site montre que le démantèlement s’inscrit dans une temporalité spécifiquement japonaise.
L’âme du Japon, puissance technologique reconnue qui a stupéfait le monde par sa faillite, doit s’actualiser non pas dans la reproduction ou la restauration d’un objet défaillant apporté par une puissance étrangère, mais dans la création de nouvelles technologies lucratives made in Japan, celles du démantèlement. Cette symbolique ne renvoie pas uniquement aux travaux de réparation menés par TEPCO et s’exprime également au sein de la société civile japonaise.
Photos et arbre miraculé

Une des photos retenues dans le cadre du concours de la NHK sur les cerisiers de Fukushima. Photo : NHK/MCJP
Depuis 2012, la NHK (le groupe des stations publiques de radio et de télévision au Japon) organise ainsi un concours photographique intitulé « Les cerisiers de Fukushima », qui se veut le symbole de la reconstruction nationale. Une exposition, organisée à la Maison de la culture du Japon à Paris du 19 au 28 mars 2019, présentera d’ailleurs trente photographies parmi les trois cent cinquante sélectionnées ou primées à ce concours.
Le projet porté par Yumiko Nishimoto s’inscrit dans ce même imaginaire. Avant l’accident de Fukushima, cette Japonaise habitait à Naraha, une ville située près de Fukushima. Évacuée, elle n’a pu revenir dans sa maison qu’en 2013. Elle lance alors un appel national au don pour planter vingt mille cerisiers « Sakura » sur les deux cents kilomètres de côte de la préfecture de Fukushima. Son objectif est de faire renaître l’espoir parmi la population. Le projet s’étale sur dix ans. Il suscite l’enthousiasme des Japonais et un millier de volontaires se mobilise pour planter les premiers arbres.
« Je veux créer la plus belle allée de cerisiers du Japon, comme un symbole de la reconstruction après la catastrophe. […] Avec ses arbres et leurs fleurs qui fleurissent chaque année, je souhaite que les Japonais gardent en mémoire cette catastrophe tout en créant un environnement dont nos enfants pourront être fiers. »
Plus récemment, le Miharu Takizakura, cerisier pleureur de plus de mille ans, a fait parler de lui dans les médias étrangers. Cet arbre, situé sur un territoire contaminé par l’accident, est considéré comme un miraculé et attire jour et nuit des dizaines de milliers de visiteurs.
Acmé de cette construction de sens, le relais de la flamme olympique, qui partira de Fukushima le 26 mars 2020 pour un voyage de 121 jours dans les préfectures nippones, au moment de la floraison des cerisiers.
Fukushima, négatif de Tchernobyl ?
Cette inscription de Fukushima dans une temporalité proprement japonaise contraste avec l’interprétation de l’événement par l’Occident et les instances internationales. Elle nous conduit en particulier à relire les rapprochements qui ont pu être faits entre Fukushima et Tchernobyl.
Le sarcophage de Tchernobyl, construit dans l’urgence pour confiner la carcasse de l’installation endommagée, frappe l’imaginaire contemporain. Avec le temps, le sarcophage s’est dégradé et une arche monumentale a été réalisée pour le recouvrir et assurer la sécurité du site pour les cent ans à venir. Autour, la zone sinistrée de Tchernobyl, interdite, est maintenue hors du temps et hors du monde. Avec son sarcophage et ses environs désertés, Tchernobyl suscite une terreur sacrée, associée à la commémoration régulière d’une nouvelle ère pour la sécurité.
Au plan institutionnel, la communauté nucléaire, sous l’égide de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), a en effet transcendé l’accident soviétique avec l’avènement du concept de « culture de sûreté », censé résoudre la question de la sécurité des centrales nucléaires.
L’AIEA a résorbé Fukushima dans ce système de significations, sans bouleverser ses fondements. Des dommages se sont produits, les enseignements tirés ont permis d’internaliser les causes dans les référentiels de sûreté existants, les résolutions prises clôturent les représentations de l’événement. La catastrophe n’était qu’un écart à l’exploitation normale des centrales nucléaires, idéalisée depuis Tchernobyl.
Pour l’AIEA, Fukushima représente donc une expérience et un événement terminés renvoyant à une conception linéaire du temps – celui de la répétition du même qui autorise la mesure – dans laquelle il est pris ; cela au même titre que l’activité nucléaire qui se poursuit dans une relative continuité à l’échelle mondiale.
La réaction du Japon à la catastrophe s’inscrit en partie dans cette temporalité : le pays a montré sa volonté de mieux se conformer aux règles internationales et a renforcé sa participation aux travaux de l’AIEA sur la prise en compte des séismes, dont il était déjà le leader. Mais cette conception occidentale d’un temps linéaire n’épuise pas l’imaginaire temporel dans lequel est saisie la catastrophe. Pour certains, au Japon, l’accident reste un défi industriel et un événement en devenir.
Les travaux menés à Daiichi actualisent une renaissance technologique du Japon, dont TEPCO entend faire étalage, là où Tchernobyl a accéléré la déliquescence de l’URSS. Cette temporalité d’actualisation s’étend d’ailleurs à toute la région à travers la politique de retour des populations. Celle-ci, si elle n’est pas sans soulever de vives polémiques, témoigne néanmoins d’une logique opposée à celle qui opère à Tchernobyl, toujours fortement investi du fait même de sa mise à l’écart du monde.
À ces deux imaginaires du temps correspondent en outre deux imaginaires de causalité. Tandis que l’AIEA a conclu que l’accident de Fukushima était la conséquence d’une culture de sécurité insuffisante – soit d’une négligence organisationnelle qui aurait déterminé une série d’effets inéluctables et prévisibles au regard des connaissances scientifiques –, les scientifiques et intellectuels japonais ont volontiers raisonné par analogie pour expliquer cet événement. En le rapprochant notamment d’autres épisodes relatifs à la Seconde Guerre mondiale, ou en l’imputant à des traits du peuple japonais dans son ensemble.
Loin de rejeter ces conclusions dans le camp de l’irrationalité, nous invitons à porter au contraire un regard réflexif sur toutes ces significations attribuées à Fukushima.
[divider style= »normal » top= »20″ bottom= »20″]
![]()
Franck Guarnieri, Directeur du Centre de recherche sur les risques et les crises, Mines ParisTech; Aurélien Portelli, Chargé d’enseignement recherche en histoire des risques industriels, Mines ParisTech et Sébastien Travadel, Chargé de recherche en ingénierie et sécurité industrielle, Centre de recherche sur les risques et les crises, Mines ParisTech
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.










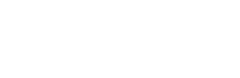


Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !