Récupérer l’uranium sans creuser : la lixiviation in situ
Face à l’augmentation de la valeur économique des ressources du sous-sol, mais aussi aux problèmes environnementaux posés par « l’après-mine », l’étude de solutions alternatives pour l’extraction des matières premières est en forte croissance, parmi elles, la lixiviation in situ pour la récupération d’uranium. A l’occasion du colloque Ressources naturelles et environnement, qui s’est tenu les 5 et 6 novembre 2014 à l’Institut Mines-Télécom, Vincent Lagneau, chercheur au Centre de Géosciences à Mines ParisTech, a présenté les résultats de l’équipe « Hydrodynamique et réactions » en matière de modèle prédictif.
La lixiviation in situ (ou ISL pour In Situ Leaching) est un procédé visant à dissoudre des métaux tels que le cuivre ou l’uranium, faciles à mettre en solution, directement dans le gisement. A l’aide d’une série de puits injecteurs et producteurs, une solution acide, dite lixiviante, est injectée dans le sous-sol, puis pompée quelques dizaines de mètres plus loin. « Pour faire de la lixiviation in situ, il faut avoir un milieu poreux, perméable et idéalement confiné, explique Vincent Lagneau, chercheur à Mines ParisTech, il faut que la solution lixiviante puisse circuler tout en évitant les fuites, qui représentent à la fois une perte d’investissement et un risque pour l’environnement. » A la sortie du puits producteur, il n’y a plus qu’à séparer les minéraux cibles du reste.

Source : thèse Ben Simon (Mines ParisTech) 2011
Cette solution alternative est parfaitement adaptée pour les gisements d’uranium qu’on exploite à l’heure actuelle : des gisements étendus, de 10 à 20 kilomètres de long, profonds et à faible teneur en uranium, qu’on ne peut pas exploiter avec des mines à ciel ouvert ou des travaux miniers souterrains. « Ça marche tellement bien que les industriels ont eux-mêmes décidé d’investir : 40% de la production mondiale d‘uranium est faite par lixiviation in situ, » principalement au Kazakhstan et en Australie.
Optimiser la technique et évaluer les impacts environnementaux
Cependant, cette technologie développée au début des années 60 est empirique. Les chercheurs tentent aujourd’hui de l’optimiser. « Cela signifie la rationaliser. Si on arrive à comprendre les processus, on pourrait actionner les bons leviers pour baisser les coûts d’opération, augmenter la quantité d’uranium récupérée et la vitesse de récupération. » Pour l’instant, il faut trois ans pour récupérer 90% de l’uranium du milieu.
L’enjeu de la recherche est aussi environnemental : « Quand on arrête l’exploitation au bout de trois ans, il reste de l’acide partout. On peut utiliser nos outils pour essayer de comprendre ce que devient le site après coup. » Il faut savoir en combien de temps le site va revenir à son état initial.
Des recherches qui couplent hydrogéologie et géochimie
« A 400 mètres de profondeur, on ne peut pas regarder ce qui se passe, on ne sait pas où est l’uranium ni comment il se comporte. » Pour comprendre ces processus, l’équipe « Hydrodynamique et Réactions » développe des modèles qui couplent hydrogéologie et géochimie. En effet, les réactions chimiques qui ont lieu entre le puits injecteur et le puits producteur sont directement liées au transport de la solution acide et des éléments dissous. Les réactions interfèrent également entre elles dans le temps et l’espace, au fil de l’écoulement de l’eau.
Une fois les processus identifiés, les chercheurs les traduisent en équation : dissolution de l’uranium, consommation de l’acide, différences de pression entre les puits, vitesse de l’eau dans le milieu… Introduites dans des algorithmes développés par Vincent Lagneau et son équipe (HYTEC), elles fournissent des résultats chiffrés, tels que la concentration d’uranium et la quantité d’acide consommée, qui peuvent être comparés à ceux observés par l’exploitant à la sortie du puits producteur. Si le modèle est correct, il peut alors servir à comprendre ce qui se passe au niveau du puits injecteur, ou entre les deux puits, mais aussi à tester d’autres scénarios d’exploitation. 50% du travail des chercheurs consiste à développer les modèles, et l’autre moitié à les appliquer. « On tient beaucoup à cet équilibre car chaque partie motive les progrès de l’autre. En appliquant les modèles, on peut identifier les besoins, améliorer notre code, et ainsi faire de meilleures études ou des études qu’on ne pouvait pas faire avant. »
Un modèle prédictif utilisé avec succès
Ce travail a été couronné de succès, puisque l’équipe de Vincent Lagneau a réussi à mettre au point un modèle prédictif, en partenariat avec AREVA, utilisé de manière opérationnelle au Kazakhstan il y a deux ans. « Aujourd’hui, si on me donne un site qui n‘a pas encore été exploité, je fais tourner mon modèle et j’arrive à dire à quoi ressemblera la courbe de production et quels seront les impacts environnementaux. C’est vraiment un résultat phare pour nous. »
A terme, l’outil développé par Vincent Lagneau et son équipe de recherche permettra de choisir la meilleure implantation et la solution à injecter pour optimiser l’exploitation du site, mais aussi d’évaluer à l’avance son impact. « On est en train d’appliquer le modèle en Mongolie sur des sites en prospection : on évalue la circulation des fluides dans le milieu jusqu’à des zones où ils pourraient remonter en surface (puits, failles), et l’évolution de sa qualité au cours de son trajet (atténuation de l’acidité, fixation de l’uranium résiduel). »
En savoir + sur le colloque Ressources naturelles et environnement
Voir l’intervention de Vincent Lagneau en vidéo
En savoir + sur le Centre de Géosciences de Mines ParisTech






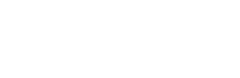

bon article pédagogique et vulgarisateur