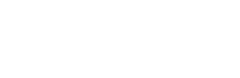Dans l’industrie automobile, le confort n’est pas un luxe : c’est une condition sine qua non de la sécurité, du succès commercial, et de la fidélisation. Un siège mal conçu ou mal ajusté suffit à rendre un trajet difficile, jusqu’à potentiellement dissuader l’achat d’un véhicule. La qualité de l’assise, la possibilité de réglage et l’adaptabilité à différentes morphologies sont désormais des critères essentiels dans l’amélioration de l’expérience de conduite, imposant l’ergonomie des sièges comme un enjeu central pour les constructeurs automobiles.
Il en est de même pour toutes les autres branches du transport, ce que Matthias Pideri, co-fondateur de la start-up PGU MEDTEC, appelle le « marché du siège ». « Certaines personnes sont parfois incapables de se relever après dix heures passées dans un fauteuil d’avion trop petit », soulève l’entrepreneur. Pourtant, malgré les enjeux économiques, ce problème reste peu investigué sur le plan médical : « Personne ne lancera des essais cliniques, long et coûteux, pour concevoir des avions et savoir par exemple à quelle hauteur limite un fauteuil pose problème », ajoute-t-il.
C’est là qu’intervient PGU MEDTEC. Fondée en 2022 par Matthias Pideri et Anabely Gutierrez, la start-up, incubée au X-UP de Polytechnique puis à Télécom Paris, s’inspire de la simulation industrielle pour explorer la mobilité humaine grâce à des jumeaux numériques anatomiques. Elle valorise ainsi des connaissances médicales dans une logique de « médecine applicative », pour répondre à des questions ergonomiques et biomécaniques sans recourir à la recherche clinique classique. Le marché des sièges, ciblé en priorité, offre un terrain concret pour démontrer l’efficacité de cette approche. Mais les perspectives s’étendent aussi aux domaines médical, de l’animation 3D, du spatial et de l’éducatif.
Visualiser le corps comme on prévisualise une auto, vis par vis
Tout commence en 2012, sur les bancs de la licence. Matthias Pideri envisage une application biomédicale des logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), qui permettent dans l’industrie de dessiner, assembler et tester virtuellement des objets physiques. « À l’époque, j’étais fasciné par le fait qu’on puisse concevoir une voiture entière, vis par vis, pour ensuite en simuler le comportement. Je connaissais les atouts de la CAO et j’ai voulu appliquer cela aux corps humains. »
Il poursuit alors un cursus interdisciplinaire entre Singapour, Prague, Barcelone, ou encore Paris, pour se former à la robotique, aux nanotechnologies, à l’entrepreneuriat… À la Sorbonne et à la Pitié-Salpêtrière, il mène ses premiers travaux en chirurgie orthopédique. Mais c’est à Barcelone, au cours d’un master dédié à l’innovation en santé, qu’il affine son ambition : concevoir des solutions numériques qui répondent aux défis de la chirurgie et de la réhabilitation.
Dès 2017, ce passionné des questions d’« ultramobilité » – soit la maximisation de la mobilité – teste à l’hôpital de la Salpêtrière un premier modèle 3D rudimentaire pour observer les mouvements articulaires de la hanche. « Notamment le comportement de prothèses de hanche en fonction de pathologies comme la scoliose », précise-t-il. Puis il pousse l’expérimentation plus loin, sur la visualisation de la bascule du bassin. « L’orthopédie a longtemps été le parent pauvre dde l’innovation médicale – hors matériaux – car c’est un champ coûteux, qui mobilise beaucoup d’appareils et d’électronique », observe Matthias Pideri. Pour l’entrepreneur en devenir, le choix d’une approche 100 % logicielle s’est donc imposé naturellement.
Du squelette aux avatars complexes, des modèles légers…
L’offre imaginée Matthias Pideri et Anabely Gutierrez se décline en trois modules : un jumeau squelettique, fait uniquement d’os, de ligaments, de disques et de cartilages ; un modèle musculosquelettique, complété par les muscles et les tendons ; et un avatar morphologique. Ce dernier, hautement personnalisable, permet de représenter les morphologies les plus diverses, avec un focus sur les déformations du volume corporel (abdomen, cuisses, thorax) et dans quelle mesure ce volume contraint ou limite la mobilité.
Sur la base de cette offre, la start-up essaie de lever deux verrous technologiques : la complexité informatique et l’adaptabilité de ses modèles. En effet, la complexité des outils de CAO appliqués au corps humain posait jusqu’ici un double problème : des modèles trop lourds à faire tourner et une puissance de calcul difficile à mobiliser. « Certes, il existait des visualisations très détaillées de certaines parties anatomiques, mais il manquait les connexions essentielles : c’était comme modéliser les roues d’une voiture sans simuler leurs mouvements, et donc en déduire qu’elles sont immobiles », illustre Matthias Pideri.
De plus, ils nécessitaient des serveurs puissants, voire des données d’imagerie comme l’IRM, difficiles à obtenir et à exploiter. PGU MEDTEC propose donc d’assembler toutes les pièces anatomiques entre elles, dans une configuration légère : la modélisation fonctionne sur un simple PC équipé d’une carte graphique. Pas besoin de recourir à une infrastructure informatique spécialisée, ni à de l’imagerie médicale avancée.
…et tout-terrains
La start-up se positionne ainsi sur un segment hybride, entre modélisation médicale et analyse ergonomique, qu’Anabely Gutierrez veille à encadrer sur le plan réglementaire. « Il y a beaucoup de processus à respecter en matière de qualité et de normes, à l’échelle française et européenne », souligne cette ingénieure spécialisée en valorisation médicale et en qualité. Le cadre de conformité est exigeant mais néanmoins plus souple que pour les dispositifs médicaux classiques. « Notre crédo, c’est la médecine applicative, donc utiliser des connaissances médicales pour un logiciel non-médical, mais qui nécessite une conformité réglementaire », nuance Matthias Pideri.
Ce positionnement, finalement plus orienté vers la performance que vers le soin, rapproche naturellement PGU MEDTEC de secteurs comme le sport ou la défense, où on parle « d’ultramobilité, pas de médecine ». Il en résulte des applications variées : de l’optimisation de sièges chez Airbus ou dans le ferroviaire, à l’étude de la microgravité sur la colonne vertébrale en partenariat avec le Centre national d’études spatiales (CNES). « Cette capacité à transposer nos modèles à plein de domaines est vraiment notre deuxième force après la simplification des modèles », résume Matthias Pideri.
Déjà dans la course et plein de projets au garage
Tant et si bien que la technologie de PGU MEDTEC s’adresse également à la formation. Dans un contexte où la réforme du troisième cycle des études de médecine valorise davantage la pratique, le besoin d’outils interactifs et visuels se fait de plus en plus pressant. « L’enseignement de la chirurgie reste très archaïque. Il repose presque uniquement sur la pratique, et il faut parfois plusieurs années pour se spécialiser, maîtriser… en plus du cycle d’étude standard ! », rappelle Matthias Pideri. En exposant les étudiantes et étudiants à une grande variété de cas simulés en quelques clics, les jumeaux numériques offrent une méthode d’apprentissage complémentaire et rapide.
En résumé, la solution développée par la start-up ne se limite pas à la pratique médicale, mais s’étend bien au-delà, à l’ingénierie, au design industriel ou encore à la formation, partout où il est nécessaire de comprendre visuellement l’impact d’un produit sur le corps. Cette polyvalence reflète l’identité hybride de PGU MEDTEC, dont l’objectif est de devenir un éditeur logiciel à part entière.
Pour ce faire, deux entités sont envisagées : un bureau d’études dédié à la recherche et l’innovation en chirurgie, et médecine spaciale et militaire, et un studio 3D pour le développement et les applications logicielles dans l’industrie, l’animation et la création visuelle. « Avec le déferlement de l’IA, il y a une vraie demande de la part de l’industrie comme du médical pour des images 3D qualitatives, certifiées, et fiables, sans nécessairement l’accompagnement proposé par la plupart des éditeurs de logiciel », justifie Matthias Pideri. Le lancement des versions beta des modules « squelette » et « » prévu pour 2025 marquera déjà une étape décisive dans la mise à l’épreuve de ces jumeaux numériques, avec de premiers usages concrets en ligne de mire.