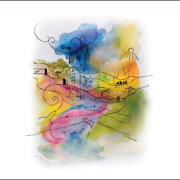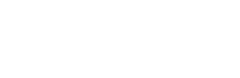En 2022, les départements de la Lozère et du Gard ont connu une année de forte sécheresse. De septembre 2022 jusqu’à mars 2023, la région a enregistré un déficit important de précipitations. Le mont Aigoual, point culminant du département du Gard, a recensé deux fois moins de pluie qu’à l’accoutumée dans cette période. Ce n’est cependant pas un phénomène inédit dans l’histoire du territoire : dans les années 1940, une grande sécheresse avait fortement marqué les esprits.
En effet, cette décennie anhydre avait présenté des déficits pluviaux records, qui restent plus important que ceux enregistrés ces dernières années. Mais la donne a changé, car aujourd’hui, le spectre du réchauffement climatique se dessine un peu plus chaque année.
Crée en juin 2023, le projet LabOVivant(s) a pour objectif d’analyser les interactions sociohydrologiques en période de sécheresse et de remédier au manque d’eau dans les Cévennes. « Actuellement, le territoire n’est pas préparé à revivre une situation de stress hydrique comparable à celle des années 1940 par exemple. Or historiquement, on voit que les situations de sécheresse reviennent, de manière presque cyclique. Donc il y en aura d’autres », alerte Juliette Cerceau, enseignante-chercheuse à IMT Mines Alès, et impliquée dans le projet LabOVivant(s).
Le living lab : quand la recherche devient citoyenne
Co-financé par la Zone Atelier Bassins-du-Rhône (ZABR) et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, le projet LabOVivant(s) est un living lab, un laboratoire scientifique qui s’inscrit dans une démarche participative. Il rassemble des institutions comme IMT Mines Alès, le CNRS, INRAE, ainsi que des scientifiques qui proviennent d’horizons disciplinaires différents, comme des sociologues, des hydrologues, ou encore des géographes.
Mais surtout, le concept de living lab se caractérise par l’inclusion de la population locale dans le processus de recherche. « Le principe d’un laboratoire vivant est de construire les actions de recherche avec les acteurs publics et les habitants, qui sont concernés par des problématiques socioécologiques. De ce fait, les travaux menés sont cohérents avec les attentes du territoire », explique Juliette Cerceau. Cette approche pluridisciplinaire et authentique permet d’orienter la recherche vers des problématiques précises, et de répondre à des besoins formulés par des citoyens et citoyennes de la région. « Nous essayons de construire un climat de confiance, le but est de faire participer le plus de monde possible », ajoute-t-elle.
Contrôler la qualité de l’eau avec l’aide des locaux
Bien que la sécheresse représente une menace majeure pour la région, elle semble épargner les Cévennes en cette année 2025. Néanmoins, les habitants et les habitantes doivent faire face à d’autres problématiques, comme celle de la qualité de l’eau. Dans le cadre de la recherche menée par le LabOVivant(s), trois étudiantes d’IMT Mines Alès ont conduit une étude visant à mesurer la présence de métaux dans certaines sources du territoire. Parmi ces métaux : l’arsenic, hautement toxique pour les êtres vivants.
« Les sols des Cévennes sont naturellement riches en métaux divers, mais une telle concentration peut aussi s’expliquer par l’activité humaine et l’exploitation minière séculaires », précise la chercheuse. Afin d’effectuer localement et régulièrement des mesures de concentration, les étudiantes d’IMT Mines Alès ont imaginé un protocole de tests et de prélèvement réalisables par des personnes non expertes, habitant à proximité des sources. Ces tests, effectués avec des bandelettes, permettent de déterminer par colorimétrie le niveau de présence des métaux comme l’arsenic donc, mais aussi le zinc, le fer, ou le plomb. Un premier atelier a été réalisé en amont, afin de répondre aux questions des scientifiques en herbe, et faire passer clairement les consignes.
Les Cévenols et Cévenoles sont également mis à contribution sur le suivi des précipitations. Sur la commune des Plantiers, de nombreux pluviomètres ont été installés et sont gérés en autonomie par les résidentes et résidents. Cette autogestion permet aux scientifiques d’être en dialogue permanent avec les locaux, dont l’eau est une des principales sources d’inquiétude. « Quand on se met à l’écoute des savoirs locaux, on se rend compte à quel point les habitants nouent une relation étroite, presque intime, avec leurs cours d’eau et leurs sources », détaille Juliette Cerceau.
Un outil pour anticiper et réagir face à la crise climatique
En permettant ainsi aux habitantes et habitants de s’investir dans ce projet de recherche appliquée, un véritable travail de sensibilisation s’effectue. Si les déficits pluviaux vont et viennent, le réchauffement climatique et la hausse des températures sont des constantes absolues sur ces dernières années. Il est donc nécessaire de prévenir les populations, puis de préparer les territoires aux solutions face aux sécheresses qui arriveront, tôt ou tard.
C’est au travers de cette démarche participative que toutes les questions complexes peuvent être posées, et que les besoins locaux peuvent être écoutés. « Qu’est ce qui se joue entre l’activité touristique, la sécheresse, et la qualité de l’eau ? Qu’est ce qui se joue entre la sensibilisation et la consommation des familles ? Le laboratoire vivant cherche à faire réfléchir les gens sur ces interactions, qui sont toutes liées », illustre Juliette Cerceau.
Avancer pas à pas
L’initiative LabOVivant(s) n’est pas particulièrement couteuse, les outils comme les échantillons ou les pluviomètres sont abordables. La principale ressource que requiert une étude participative, c’est du temps. « La dynamique d’un travail de recherche participatif est très différente d’un travail de recherche classique. Elle dépend beaucoup de la disponibilité des gens, du temps qu’ils ont à nous accorder », constate la chercheuse. « Les résultats de l’étude dépendent aussi de la temporalité du territoire : on ne peut pas effectuer des prélèvements à n’importe quel moment de l’année, il y a donc un rythme à trouver. »
Une thèse lancée en octobre prochain, s’attachera à examiner rétrospectivement l’ensemble du processus participatif, à identifier les pistes d’amélioration, et à évaluer de manière approfondie les retombées de cette initiative. « À l’heure actuelle, il est difficile d’avoir du recul sur les dispositifs d’observation et de mesurer la réussite du projet », explique Juliette Cerceau.
Cependant, la scientifique ne doute absolument pas des bienfaits et des résultats qu’apporteront LabOVivant(s). « Je suis convaincue que la démarche participative a un potentiel. Elle transforme les représentations, les pratiques techniques, les scientifiques, les citoyens, tout », assure-t-elle. Le laboratoire vivant ne se contente ainsi pas de répondre à des problématiques techniques, il sensibilise et rassemble, afin de mieux préparer les défis de demain.