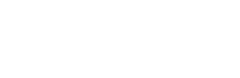IA et rareté des données
Comment vous servez-vous de l’intelligence artificielle ? Bien sûr, vous utilisez un modèle de deep learning classique, mais pas seulement ?
JPPA : Oui, nous utilisons un modèle d’apprentissage profond (deep learning) classique pour les principales structures anatomiques : sur un ensemble d’images nous repérons manuellement ces structures. Cela permet de construire un modèle de deep learning « intelligent », qui va pouvoir par lui-même, automatiquement, repérer sur d’autres images ces mêmes structures anatomiques. Ce processus de segmentation manuelle, coupe par coupe et pixel par pixel, nécessite une labellisation minutieuse des images.
Pour les nerfs, nous avons développé une méthode d’intelligence artificielle « symbolique », qui va baser son intelligence sur un ensemble de règles qui définissent l’endroit où les nerfs passent. Ce sont ces règles-là qui vont constituer l’intelligence de l’IA, et permettre ensuite à partir d’autres types d’images, qui sont des images de diffusion, de jouer un rôle de filtre pour ne laisser que le système nerveux qui est ensuite intégré au modèle 3D des structures anatomiques.
Vous parlez de labellisation, ce qui nous amène à parler de la problématique de rareté des données dans le domaine médical. En recherche médicale, les data ne sont pas ouvertes en France comme elles le sont dans d’autres pays. Comment faites-vous pour lever cet obstacle ?
JPPA : Pour développer cette technologie, nous avons utilisé des données issues d’une étude clinique entre 2016 et 2021. Cependant, ces données ne sont pas suffisantes pour construire une méthode d’intelligence artificielle robuste qui puisse fonctionner sur un grand nombre de cas. Pour enrichir notre base de données, nous achetons des données auprès de data brokers aux États-Unis, et utilisons des données publiques pour valider l’efficacité de notre produit.
L’usage des données dans le domaine médical est-il aussi contrôlé dans d’autres pays d’Europe et cela ne freine-t-il pas les innovations pour les entreprises de Medtech françaises ?
JPPA : En France, les données doivent rester au sein de l’hôpital. Cela contraint les chercheurs à utiliser les systèmes et les infrastructures des hôpitaux, limite l’accès à des infrastructures plus puissantes et rend les entreprises dépendantes des systèmes hospitaliers.
La règle est la même pour tout le monde en Europe. Mais il est vrai qu’aux États-Unis, l’accès aux données est plus simple, on le voit notamment avec l’accès à des data brokers, ce qui est beaucoup plus rare en Europe.
Il est difficile d’en mesurer les impacts sur notre compétitivité. Sans remettre en cause la nécessité d’un contrôle strict sur les données…




 Les applications sont nombreuses : traitement des tumeurs, reconstruction de nerfs endommagés par un accident, amélioration de la communication entre chirurgiens et patients grâce à des outils intuitifs de visualisation 3D.
Les applications sont nombreuses : traitement des tumeurs, reconstruction de nerfs endommagés par un accident, amélioration de la communication entre chirurgiens et patients grâce à des outils intuitifs de visualisation 3D.