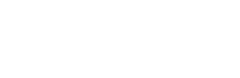En 2023, plus d’un Français sur deux déclare avoir subi une souffrance psychique au cours des 12 derniers mois. Le 30 janvier dernier, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal déclarait lors de son discours de politique générale vouloir faire de la santé mentale, en particulier celle de la jeunesse, une grande cause d’action gouvernementale. Le déploiement d’un système de prévention et de prise en charge efficace est donc plus que jamais nécessaire.
Chercheur à IMT Atlantique, Philippe Lenca collabore depuis maintenant une dizaine d’années avec le CHU de Brest sur le domaine de la psychiatrie. Avec ses collègues, Romain Billot, Yannis Haralambous et depuis récemment Gabor Bella, il a notamment participé au développement de systèmes d’information et d’aide à la décision pour des personnes atteintes de troubles psychiatriques. Des dispositifs qui permettent de détecter les signes précurseurs de pathologies comme la schizophrénie, ou de prévenir des gestes de récidives suicidaires, grâce à l’analyse de bases de données patients.
Les jeux de données socio-démographiques et médicales, enrichis au fil du temps, alimentent des modèles de risque intégrés dans des applications métiers, comme VigilanS, une plateforme de prévention du risque suicidaire implantée dans de nombreux centres d’urgence en France, et coordonnée avec le SAMU. Ces applications constituent ainsi des outils d’aide à la décision pour la mise en place de recours adaptés : maintien du lien avec les personnes en souffrance, intervention médicale, traitement, hospitalisation…
Le personnel médical garant de la qualité des données
Au fondement de ces outils, les bases de données nécessitent à elles-seules un fastidieux travail de construction. Pour la détection précoce de pathologies mentales, la collecte d’informations socio-démographiques et cliniques de qualité est cruciale. Elle est cependant conditionnée par la saisie méticuleuse du parcours de soin (transcription d’entretiens, imagerie, biologie…) dans les systèmes de santé – ce qui n’est pas toujours le cas, notamment pour les prises en charge en services d’urgence.
Pour assurer la robustesse de leurs analyses de données, les chercheurs d’IMT Atlantique ne gardent que les parcours de personnes – diagnostiquées ou à risque – complétés à au moins 80 %. La taille de leurs échantillons en est drastiquement réduite. « C’est malheureux car dans nos analyses nous cherchons généralement des signaux faibles des maladies », précise Yanis Haralambous. « Nous espérons que cela sensibilise le personnel médical au fait que pour valoriser ces données, il faut qu’elles soient de bonne qualité, et donc bien renseignées », complète Philippe Lenca.
La qualité des données dépend également de la manière dont sont renseignées les informations. « Il y a quelques années, en cas de tentative de suicide, le personnel soignant codait simplement par 1 ou 0 selon qu’il s’agissait d’une récidive ou non, mais pas le nombre de récidives. Or un suicide est généralement précédé de plusieurs tentatives ; c’est une information primordiale pour nos outils de prévention », relate Philippe Lenca.
La construction lente d’une cohorte de patients
L’identification d’une population à risque n’est pas chose aisée non plus. Dans le cas de la schizophrénie, « ce n’est pas une maladie rare au sens médical du terme, mais elle reste peu fréquente. Il y a beaucoup moins de potentiels patients que pour le suicide [voir encadré plus bas] », explique Philippe Lenca. À Brest, sur un bassin de population d’environ 300 000 habitants, entre 30 et 50 individus à risque de développer un trouble schizophrénique sont adressés chaque année par leur médecin traitant, ou encore l’assistante sociale. La construction d’une cohorte de patients à risque est donc un processus lent.
« Cet adressage est généralement basé sur des signes, qui ne sont pas clairement reliés à la dépression ou au délire. Souvent il part d’un pressentiment venant de la personne qui adresse », décrypte Michel Walter, chef du pôle psychiatrie du CHU de Brest. Ces individus « pressentis » sont ensuite suivis pendant deux ans avec des outils d’évaluation. Seuls 30 % parmi eux auront un diagnostic de trouble schizophrénique, réduisant l’échantillon final à une dizaine d’individus.
Vers un recueil de données multimodal
Au-delà de la robustesse des données, plus les bases sont fournies, meilleurs sont les outils. Afin d’en améliorer l’efficacité, l’équipe d’IMT Atlantique projette d’enrichir les bases par des données cliniques complémentaires. Une des pistes explorées est l’exploitation de données linguistiques, issues des entretiens de bilan psychiatrique, grâce au traitement automatique du langage naturel. Les signaux physiologiques enregistrés lors du parcours de soin peuvent également venir compléter ces jeux de données.
Pour la détection précoce de la schizophrénie par exemple, les équipes de recherche envisagent d’utiliser des mesures oculométriques. Ces données englobent l’information de la taille de la pupille, mais également le suivi par eye-tracking du regard. Les patients à risque schizophrénique ont un parcours oculaire singulier, en saccades, leur regard suit difficilement un objet en mouvement. Le regard est qualifié d’endophénotype : un biomarqueur de vulnérabilité de la maladie. L’ajout d’eye-tracking au dispositif permettrait ainsi d’identifier des signaux faibles mais associés au risque de développer la pathologie.
Les équipes ont déjà mis en place avec des patients des essais d’enregistrement de données physiologiques à domicile, avec un smartphone ou une montre connectée par exemple. Cette méthodologie ouvre le champ des possibles en matière de collecte : rythme cardiaque, sudation, qualité du sommeil… L’analyse de données textuelles extraites des réseaux sociaux est également envisagée. L’éventualité d’une détection précoce via cette méthode pose en revanche des questions éthiques. Quels moyens d’intervention peuvent légitimement être mis en place lorsqu’une tendance qui n’existe pas encore est détectée ?



 On peut être amené à gérer des situations de détresse partout, y compris au bureau. Ce n’est pas que dans le privé que cela se passe.
On peut être amené à gérer des situations de détresse partout, y compris au bureau. Ce n’est pas que dans le privé que cela se passe.