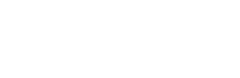Depuis les premiers pas du nucléaire, la France s’est positionnée comme l’un des leaders mondiaux, tant au niveau de la recherche que de la production d’énergie. En ce sens, l’abandon du projet Astrid en août dernier marque un renoncement à ce positionnement de chef de file. Astrid (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration) devait être le premier démonstrateur industriel français d’un réacteur dit de « 4e Génération ». La technologie choisie était celle des réacteurs à neutrons rapides (RNR) refroidis au sodium. Aujourd’hui, le parc français est composé de 58 réacteurs à eau pressurisée, de 2nde génération, fonctionnant avec des neutrons « ralentis ». Astrid, en tant que RNR, offrait la promesse d’une énergie plus durable : il devait pouvoir utiliser comme combustible l’uranium appauvri et le plutonium issus de l’exploitation du parc actuel, et donc être beaucoup moins consommateur en uranium naturel.
Dans le cadre du projet de recherche AGORAS, Stéphanie Tillement, chercheuse à IMT Atlantique, s’est penchée sur les répercussions de l’accident de Fukushima sur le monde du nucléaire. Cela l’a amenée à étudier le projet Astrid, et en particulier sa trajectoire difficile. « Très vite, nous avons écarté le lien avec Fukushima » révèle la chercheuse. « Les difficultés rencontrées par Astrid ne sont pas liées à un changement de paradigme post-catastrophe. Les raisons de son abandon sont endogènes à la filière et son histoire. » Et les raisons financières, bien que non négligeables, ne suffisent pas à l’expliquer.
Une histoire tumultueuse
Dans les années 2000, le département de l’Énergie des États-Unis lance le Forum International Génération IV, pour développer une coopération internationale sur les nouveaux concepts de réacteurs nucléaires. Parmi les 6 concepts choisis par ce Forum comme les plus prometteurs, la France se centre sur le réacteur refroidi au sodium, un projet qui sera lancé en 2010 sous le nom d’Astrid. Si le pays préfère ce concept, c’est notamment parce que trois réacteurs français de cette technologie ont déjà été construits auparavant. Cela dit, aucun n’a été exploité à l’échelle industrielle, et cette technologie n’a pas dépassé le stade du prototype. Le premier, c’était Rapsodie, purement dédié à la recherche. Le deuxième, Phénix. Intermédiaire, il devait produire de l’énergie mais restait un réacteur expérimental, loin d’une échelle industrielle. C’était le rôle de Superphénix, le troisième, d’être le premier de série de cette nouvelle filière industrielle française. Mais, dès le début, il connaît des périodes de mise à l’arrêt suite à plusieurs incidents. En 1997, Lionel Jospin annonce son arrêt définitif.
« Cette décision sera grandement critiquée par les acteurs du monde nucléaire » souligne Stéphanie Tillement, « qui lui reprocheront de se fonder sur de mauvaises raisons ». Alors en campagne, Lionel Jospin s’allie au parti Les Verts, ouvertement en faveur du démantèlement de la centrale. « Son arrêt brutal sera très mal vécu et ruine tous les espoirs de passage à une échelle industrielle. Superphénix devait être le premier d’une grande lignée, et certains s’en souviendront comme ‘une cathédrale dans le désert‘ ». Cela dénote aussi l’opinion publique sur le nucléaire : une filière recevant de plus en plus de méfiance et de contestation.
« Pour beaucoup d’acteurs du nucléaire, notamment au CEA (Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives), Astrid portait l’espoir de faire revivre cette technologie très prometteuse » poursuit la chercheuse. L’un des grands avantages, c’est la possibilité d’un cycle du nucléaire fermé. Cela offre la capacité de recycler les matières nucléaires issues du parc actuel, comme le plutonium, pour l’utiliser comme combustible dans les réacteurs. « Dans ce cadre-là, l’abandon d’Astrid, pourrait, à long-terme, remettre en question l’existence même de l’usine de retraitement de la Hague », précise-t-elle. Cette usine traite le combustible usé, dont une partie (le plutonium notamment) est réutilisé dans les réacteurs, sous la forme de combustible MOX. « Sans réacteur capable d’utiliser de façon efficace les matières retraitées, il devient difficile de justifier son existence ».
« Dès le début, nos entretiens montrent que les acteurs d’Astrid ont eu des difficultés à définir précisément le statut du projet » indique Stéphanie Tillement. Le concept défendu lors de la demande de financement, c’est un démonstrateur industriel. L’objectif est alors de construire, sur un planning assez court, un réacteur capable de produire de l’énergie à grande échelle avec une technologie pour laquelle on dispose d’un retour d’expérience non négligeable. Mais pour le CEA, Astrid est aussi un projet de recherche, pour améliorer la technologie et développer de nouvelles options de design. Et cela requiert beaucoup plus de temps. « Plus le projet avance » ajoute la chercheuse, « plus le CEA s’oriente vers une approche de recherche et développement. Le concept s’éloigne des réacteurs précédents et son développement en est retardé. Lorsqu’ils ont dû présenter la feuille de route en 2018, le projet était à un stade de ‘basic design’ et demandait encore beaucoup de travail, en conception, mais aussi pour démontrer le respect des exigences de sûreté nucléaire ».
Un projet arrêté, ou reporté ?
Stéphanie Tillement l’affirme, « le projet Astrid, tel qu’il était initialement présenté, est définitivement abandonné ». Les travaux sur la technologie sodium sont supposés se poursuivre, mais la construction d’un éventuel démonstrateur de cette technologie, elle, est reportée à la deuxième moitié du XXIe siècle. « C’est un choix pensé sur le court-terme » insiste-t-elle. L’uranium, utilisé pour faire tourner les réacteurs, est peu cher aujourd’hui. Il n’est donc pas nécessaire de se tourner vers des ressources plus durables, du moins pas encore. Mais l’arrêt du projet Astrid met en péril les compétences acquises sur cette technologie. Bien que certains travaux de recherche puissent subsister, ils ne suffisent pas à maintenir le savoir-faire industriel en développement de nouveaux réacteurs, et les connaissances dans ce secteur pourraient bien se perdre. « Le processus de réapprentissage de connaissances perdues » complète-elle, « est finalement aussi coûteux que de partir d’une feuille blanche ».
Un choix à court-terme donc, misant plutôt sur les EPR, les réacteurs de 3e génération. Seulement, la construction à Flamanville d’un réacteur de ce type fait face elle aussi à son lot d’obstacles. Selon Stéphanie Tillement « les difficultés rencontrées par le projet Astrid ont des similitudes avec celles du projet d’EPR ». Pour obtenir les financements de tels projets, les acteurs du nucléaire cherchent à s’aligner avec les temporalités courtes du monde politique. Or, un planning serré est au final très peu réaliste, et non cohérent avec les temporalités de développement de technologies nucléaires, encore moins lorsqu’il s’agit d’un premier de série. Cela met les projets nucléaires en difficulté : ils accumulent du retard et leur budget s’envole. Ce qui, in fine, rend les politiques plutôt frileux à l’idée de financer ce type de projet. « C’est un cercle vicieux dans lequel s’embourbe le nucléaire » résume la chercheuse, « dans un monde de moins en moins favorable à ce secteur ».
Cette décision s’ancre également dans une stratégie énergétique du gouvernement. Dans les grandes lignes : l’État a annoncé une réduction à 50% de la part du nucléaire dans le mix énergétique de la France, en faveur des énergies renouvelables. « Le problème » souligne Stéphanie Tillement, « c’est que nous n’avons que les grandes lignes. S’il y a une stratégie politique sur les questions nucléaires, elle reste floue. Et il n’y a pas de positionnement à long-terme, c’est une manière de laisser les choix aux futurs décideurs. Mais ne pas choisir, c’est aussi un choix. Ne pas se lancer maintenant dans le développement de technologies qui nécessitent du temps pour être au point, c’est peut-être, implicitement, renoncer à le faire un jour. Ce qui pousse certains à considérer un peu cyniquement que les politiques se disent peut-être que lorsqu’on en aura besoin, on achètera la technologie nécessaire à d’autres puissances (Chine, Russie) qui elles, l’auront développée ».